« ‹ Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ›. Peu de voies répondirent – écrit Engels à l’occasion du 1er mai 1890 – quand, il y a désormais quarante-deux ans, nous lancions ces paroles au monde, à la veille de la première révolution de Paris qui avait vu le prolétariat avancer ses propres revendications. Mais les prolétaires de la plupart des pays d’Europe occidentale se réunirent le 28 septembre 1864 dans l’Association Internationale Ouvrière de glorieuse mémoire. Certes, l’Internationale elle-même n’a vécu que neuf années. Mais justement cette journée est le témoignage du fait que la Ligue éternelle des prolétaires du monde entier fondée par l’Internationale vit encore, et vit plus fortement que jamais. Parce qu’aujourd’hui, alors que j'écris ces lignes, le prolétariat d’Europe et d’Amérique passe en revue ses forces mobilisées pour la première fois comme une seule armée, sous un seul drapeau, pour un seul but immédiat : la journée de travail de huit heures, déjà proclamée par le Congrès de Genève de l’Internationale en 1866, et de nouveau par le Congrès de Paris de 1889, pour en faire une loi. Et le spectacle de cette journée ouvrira les yeux aux capitalistes et aux propriétaires terriens de tous les pays sur le fait qu’aujourd’hui le prolétariat de tous les pays s’est effectivement uni. Que Marx fut à côté de moi pour le voir de ses yeux ! »[1].
Jusqu’à la fin, le vieux compagnon de Marx crut que la révolution ouvrière était « certainement proche »[2]. La social-démocratie allemande, affirmera-t'il peu avant de mourir, à cinq années de la fin du siècle, augmente « de manière spontanée, constante, irrésistible, et en même temps tranquille, comme un processus naturel. […] Avançant de ce pas, nous aurons conquis pour la fin de ce siècle la majeure partie ces classes moyennes de la société, des petits-bourgeois aussi bien que des petits-paysans, et nous serons devenu la force décisive du pays, devant laquelle toutes les autres devront s’incliner, que nous le voulions ou pas »[3].
Engels se rendait certes compte qu’il ne s’agirait pas d’une idylle, que le capitalisme préparait une guerre mondiale dans laquelle « quinze ou vingt millions d’hommes armés s’entre égorgeraient et dévasteraient l’Europe comme elle ne l’avait jamais été ». Il était toutefois conscient du fait que « cette guerre produirait le triomphe immédiat du socialisme, ou bien bouleverserait tellement le vieil ordre des choses, et laisserait derrière lui un tel amas de ruines que la vieille société capitaliste deviendrait plus impossible que jamais »[4].
Cette vision optimiste des perspectives de la lutte de classe était sans doute influencée par la « grande dépression » que l’économie capitaliste internationale, à partir de 1873, était en train de traverser et qui dura, avec des phases alternées, jusqu’à la moitié des années 90[5], faisant avancer au vieil Engels l’hypothèse que la « forme aiguë » de la vieille crise capitaliste avec ses « cycles décennaux » puisse avoir laissé la place à « une alternance, de caractère chronique et de plus longue durée, de périodes de reprises relativement courtes et peu accentuées, et de périodes de dépression relativement longues et sans solutions » ou, comme alternative, que le capitalisme fut entré « dans la phase préparatoire d’une nouvelle crise mondiale d’une violence inouïe »[6]. Surtout l’optimisme d’Engels était plus que justifié par l’observation des immenses progrès accomplis par le mouvement ouvrier au cours du XIXe siècle. Celui-ci n’avait pas seulement vu l’affirmation de la bourgeoisie et de l’industrialisme, l’élaboration de la dialectique de Hegel, se succéder les découvertes comme celles d’Ohm, de Faraday, Hertz dans le champ de l’électromagnétisme, de Darwin, Mendel, Pasteur, Haeckel dans celui de la biologie, de Mendeleïev en Chimie. L’utilisation toujours plus ample de la vapeur – héritée du siècle précédent – et des métiers mécaniques, l’épopée du chemin de fer et des vaisseaux transocéaniques, joints au marché mondial et au capitalisme, avaient favorisé un développement grandiose du mouvement ouvrier.
En Angleterre, celui-ci avait fait ses premiers pas à la fin du XVIIIe siècle pour s’affirmer en 1810 avec la grève des mineurs de Durham et la diffusion du Ludisme les années suivantes. En 1824 il était déjà suffisamment fort pour obtenir une première révocation des lois contre les associations industrielles ouvrières, en 1838–39 pour dépasser le niveau trade-unioniste et surgir, avec le Chartisme, comme mouvement politique, obtenant en 1847, à la veille de la révolution européenne, les dix heures.
Pendant ce temps – après sa première dramatique annonce à la fin du XVIIe avec Babeuf et les « égaux » – la lutte de la classe ouvrière faisait son apparition en 1831 sur le continent grâce au mouvement des ouvriers de la soie (les canuts) à Lyon, qui s’insurgèrent au cri de « vivre en travaillant ou mourir en combattant ! ». En 1848, pendant que le Chartisme anglais est à son apogée, le Paris prolétarien s’insurge sous la bannière communiste de Blanqui, dans la première tentative historique d’imposer sa propre dictature de classe. Par cette ardente anticipation le prolétariat français se substituait au prolétariat anglais à l’avant-garde du mouvement ouvrier européen.
La grave défaite de la révolution de 1848 n’empêcha pas, selon les paroles de Marx, que ses propres fossoyeurs ne deviennent ses « exécuteurs testamentaires » en ce qui regarde la réalisation des postulats bourgeois : État national en Italie et en Allemagne, marché, commerce et industrie partout. En ce qui regarde la classe ouvrière, dès 1864, comme le note Engels, elle est en état de se réorganiser, et sur un plan plus élevé, créant sa première « Association Internationale », dont les statuts posaient le concept de ce que « l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». La réalisation de cette organisation, héritée par bien des aspects de la vieille et désormais dissoute « Ligue des Communistes » qui avait chargé Marx et Engels d’écrire le plus grand best seller de tous les temps, était par rapport à cette première tentative d’avant-garde comme l’arbre adulte par rapport au tendre rejeton. Ce n’est pas pour rien qu’en dépit du caractère minoritaire de ses membres dans la Commune de Paris en 1871 l’ensemble du monde bourgeois ait attribué à l’« Association Internationale des Travailleurs » la responsabilité politique et morale de la première réalisation historique d’un gouvernement ouvrier autonome.
Suivant des sources de police (sûrement exagérées) celle-ci arriva à organiser au maximum 800 000 membres[7], lesquels, comme c’était prévu par les principes, maintenaient leur éventuelle appartenance à l’organisation syndicale, politique ou mutualiste à laquelle ils étaient affiliés dans les divers pays (ce qui faisait de l’A.I.T. une sorte de super-parti international superposé aux formes locales d’organisations ouvrières). Son « programme », bien que rédigé par Marx, était si général qu’il laissait la place aux trade-unionistes anglais, aux Mazziniens, aux Proudhoniens et aux anarchistes. L’unique condition réclamée était de ne pas s’opposer aux principes des Statuts de l’A.I.T. et en particulier à l’idée de l’émancipation de la classe ouvrière. Nonobstant ces limites, qui conduirent à une suite de luttes intestines et enfin à sa dissolution, la Première Internationale, comme le dira Lénine, « avait jeté les fondements de l’organisation internationale des ouvriers pour la préparation de leur assaut révolutionnaire contre le capital »[8] et, malgré sa crise les années suivant la guerre civile en France, des expériences de ce premier grand parti politique international prolétarien – qui contribua aussi à la diffusion de l’organisation syndicale du prolétariat dans de nombreux pays – germèrent les grands partis socialistes nationaux, qui auront imprimé leur image indélébile à la marche de l’histoire européenne du dernier quart de siècle, imposant aux principales nations modernes la reconnaissance, de jure ou de facto, de partis ouvriers indépendants et de vastes organisations économiques pour la défense des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.
En 1889, à l’occasion du centenaire de la Révolution française, rue Petrelle le mouvement socialiste européen et le prolétariat américain manifestèrent la volonté d’avoir une coordination internationale de lutte pour les « huit heures » et des partis ouvriers, donnant vie à ce qui fut appelé l’« Internationale Socialiste » ou « Seconde Internationale ». Dix-sept ans s’étaient passés depuis que le Congrès de La Hayes avait décidé la dissolution de l’A.I.T. L’intervalle ne s’était pas passé en vain : en 1875 on avait assiste en Allemagne à la réunification entre les Lassaliens de l’« Association générale des ouvriers allemands » et le « Parti ouvrier social-démocrate allemand » d’inspiration marxiste. En 1879 était né en France, se réclamant de Marx et d’Engels, la « Fédération du Parti des Travailleurs ». Le « Parti Ouvrier Belge » fut fondé en 1885. En Italie il faudra attendre 1892. De toute manière, malgré l’hétérogénéité des différents partis nationaux et la faiblesse des liens entre eux (la IIe Internationale était une fédération d’organisations autonomes), le développement du mouvement ouvrier continuait à grands pas, même si celui ci était plus net sur le plan quantitatif que qualitatif. Il ne manqua pas de belles pages de luttes contre le pur trade-unionisme, la maçonnerie, le révisionnisme et surtout l’anarchisme.
Pendant que s’étendait l’organisation politique autonome du prolétariat, l’organisation syndicale avançait aussi en transformant ses caractéristiques : née en Angleterre comme organisation de métier de la force de travail skilled (qualifiée), pour maintenir les salaires élevés et défendre le professionnalisme de ses adhérents, les syndicats ouvriers avaient peu à peu dépassés ces limites originelles, d’une certaine manière ancrées au passé manufacturier; non seulement celle-ci, comme Marx et Engels l’ont de nombreuses fois soulignés, montrait, dans la mesure dans laquelle elle s’opposait à l’organisation de la main d’œuvre non spécialisée, certains traits réactionnaires invalidant sa potentialité classiste, mais elle se démontrait de moins en moins capable de s’opposer à l’exploitation au fur et à mesure que le machinisme s’emparait de secteurs de plus en plus vastes de l’économie, dévaluant la valeur de la spécialisation dans les processus de production; ainsi l’organisation ouvrière de métier fut peu à peu doublée puis substituée (même si ce fut par un processus loin d’être linéaire et rapide) par les syndicats d’industrie, qui ne s’affirmèrent complètement que dans la seconde moitié du siècle suivant, avec le succès de l’entreprise fordiste comme organisation de tous les ouvriers d’une entreprise déterminée et/ou directement d’une branche d’industrie déterminée, unique moyen de s’opposer à la pression exercée par un capital de plus en plus centralisé.
À cheval entre les deux siècles la force rassemblée du mouvement ouvrier apparaissait impressionnante, en particulier en Allemagne, la nouvelle avant-garde du prolétariat mondial :
« Le Parti ouvrier social-démocrate allemand compte en 1914 1 085 905 adhérents. Ses candidats aux élections législatives de 1912 ont obtenu 4 250 000 votes. Les syndicats qu’il a créé et qu’il contrôle comptent plus de 2 000 000 d’inscrits et disposent d’un compte de 88 millions de marks. À l’intérieur du Parti les militants ont su tisser un vaste réseau d’organisations parallèles qui encadrent, à différents niveaux, la quasi totalité des salariés, et s’étendent à tous les champs de l’activité sociale : association des femmes socialistes, mouvement de jeunesse, universités populaires, bibliothèques et centres de lecture, organisations récréatives, maisons d’éditions, journaux, revues. L’édifice repose sur les solides fondations d’un appareil administratif et technique compétent et efficace, expert en critère de gestion moderne et de propagande. Dans ses quatre-vingt dix quotidiens le parti emploie 267 journalistes, 3000 ouvriers et employés, gérants, directeurs commerciaux, représentants. La majorité des dirigeants, en particulier les membres de la direction (le Parteivorstand) et des bureaux centraux, les responsables des différents États, une grande partie des secrétaires des organisations locales, sont des fonctionnaires permanents, professionnels stipendiés qui travaillent à plein temps pour le parti. Le sont aussi une grande partie de ses représentants, les 220 députés que le parti compte dans les différents Landtag et les 2886 élus communaux. Les dirigeants des fédérations syndicales, des syndicats de métier et des unions locales sont aussi fonctionnaires depuis des années et sont dans leur quasi totalité membres du parti »[9].
Comme l’écrivit plus tard Ruth Fischer :
« Le Parti social-démocrate allemand devint un mode de vie. Il fut bien plus qu’une machine politique : il donnait à l’ouvrier allemand une dignité et un rang dans son propre monde.
Ses idées, ses réactions, ses attitudes résultaient de l’intégration de sa personne dans cette collectivité »[10].
« Le parti social-démocrate [allemand] – a écrit Rosa Luxembourg – n’est pas lié à l’organisation de la classe ouvrière, il est le mouvement de la classe ouvrière »[11].
Cette force immense, cette influence enracinée, n’expliquent pas seules l’incrédulité qui s’empara des gauches socialistes lorsque, en août 1914, les partis de la IIe Internationale cédèrent, chacun pour leur compte et à peu d’exceptions, aux sirènes de la « défense de la patrie », reniant toutes les proclamations antimilitaristes et internationalistes de la veille; elles expliquent aussi la paralysie qui s’empara du mouvement ouvrier international et la manière tardive et chaotique dont il réagit de manière classiste et révolutionnaire à cette guerre générale qu’Engels avait lucidement anticipé sans toutefois prévoir son tragique effet sur la social-démocratie.
Pourquoi donc alors que « les conditions objectives du socialisme sont arrivées à complète maturité »[12], la social-démocratie a t-elle fait honteusement banqueroute ? Il faut tout d’abord observer que les prévisions d’Engels relatives à la prolongation ou à l’aggravation de la « grande dépression » ne se sont point réalisées. A partir de la moitié des années 90, le capitalisme, un capitalisme profondément changé et caractérisé de manière croissante par les cartels, les trusts, les monopoles, avait commencé un nouveau cycle d’expansion : l’investissement extérieur anglais en 1913 dépassait de deux fois et demi le record précédent la grande dépression, la même chose était advenue pour les exportations de fer et d’acier entre 1895 et 1910, et, pendant que les marchandises américaines envahissaient les marchés européens, les exportations britanniques de machines-outils avaient plus que triplées[13]. Ce n’est pas un hasard si l’année 1899, il y a cent ans, le protégé d’Engels, Édouard Bernstein, publiant « Die Voraussetzungen des Socialismus »[14], donne le départ au débat sur le « révisionnisme » : les prévisions de Marx sur l’« écroulement » du capitalisme et l’augmentation de la misère – lit-on dans ce livre – se sont révélées fausses, la perspective révolutionnaire doit donc être abandonnée à la faveur d’un travail voué à l’obtention de réformes structurelles de la société présente et à des améliorations immédiates de la condition des classes inférieures; le socialisme « scientifique » s’était révélé erroné et devait être substitué par un socialisme éthique, par un idéal se poursuivant à travers un lent et pacifique travail de transformation.
« Les conditions objectives de la fin du XIXe siècle – expliquera Lénine – ont particulièrement renforcées l’opportunisme, transformant l’utilisation de la légalité bourgeoise en une attitude servile face à celle-ci, créant une petite couche de bureaucrates et d’aristocrates de la classe ouvrière, attirant dans les rangs des partis socio-démocrates de nombreux ‹ compagnons de route › petit-bourgeois. La guerre a accéléré ce développement, transformant l’opportunisme en social-chauvinisme, rendant manifeste l’union secrète des opportunistes avec la bourgeoisie […]. La base économique de l’opportunisme et du social-chauvinisme est identique : les intérêts d’un très petit groupe d’ouvriers privilégiés et de petit-bourgeois qui défendent leurs propres privilèges, leurs propres ‹ droits › aux miettes des profits obtenus par ‹ leur › bourgeoisie nationale au détriment des autres nations, avec ses avantages de position de grande puissance, etc. »[15].
Les réactions de l’aile « orthodoxe » de la social-démocratie, incarnée par Kautsky, selon lequel Marx n’avait pas élaboré une théorie simpliste de l’« écroulement »[16], ou la défense passionnée par Rosa Luxembourg en 1913[17] de l’inévitabilité de celle-ci, ne résolurent pas la question de la « crise du marxisme » soulevée par le débat de Bernstein : si d’un côté Kautsky réaffirme la prévision d’une « chronicité » de la crise en contradiction avec les dernières années de la vie économique mondiale[18], de l’autre Rosa Luxembourg – répondant en particulier à ceux qui, comme Tugan-Baranovsky, reprend dans les schémas de la reproduction du livre II du « Capital » la démonstration des possibilités illimitées d’expansion de l’économie bourgeoise – pensait nécessaire, pour sauver la prévision d’une fin certaine du capitalisme, de « corriger » Marx et sa théorie de l’accumulation. Selon sa vision le capital ne pouvait vivre qu’en expansion vers l’extérieur par la colonisation des aires non-capitalistes, et il serait tombé lorsque cette possibilité aurait été en s’amenuisant.
L’éclatement de la « grande guerre », confirmant les prévisions d’Engels, porta l’affrontement du plan théorique à celui immédiatement politique : les gauches révolutionnaires de la social-démocratie virent dans le conflit la confirmation de ce que le capitalisme était destiné à une fin sanglante. Aucune des guerres précédentes n’avait eu d’effets aussi catastrophiques : commencée avec les mules, les baïonnettes et les charges de cavalerie, elle se poursuivit peu à peu avec des armes jamais vues avant ces destructions de masse : mitrailleuses, cuirassés et croiseurs, sous-marins, aviations, gazes, chars d’assaut, artillerie de toutes dimensions, projectiles de toutes formes. La société des machines avait produit la guerre des machines, sa puissance productrice devenait puissance destructrice. Le champ de bataille se transforma du terrain du romantique héroïsme des années 1800 en chaîne de montage de massacres synchronisés. La dernière guerre du dix-neuvième siècle, celle entre l’Allemagne et la France, avait fait 150 000 morts. Le premier jour de la bataille de la Somme, qui coûta dans son ensemble 1 200 000 morts, les Anglais accusèrent des pertes de 60 000 hommes. À la fin de la guerre pas moins de 10 000 000 de personnes avaient perdu la vie sur le front.
À la place des 25 États de 1914, l’Europe en comptait 33 après la paix de Versailles, résultat de la dissolution de l’Empire Austro-Hongrois et de la fin de la domination russe sur la Pologne, la Finlande et les États Baltes. Les causes de la guerre résultaient en dernière instance de la concurrence inter-impérialiste, mais la détonation était venue des Balkans, où la dissolution de l’Empire Turc, outre le réveil des nationalismes serbe, grec et bulgare, avait avivé les appétits austro-hongrois et russes vers les « mers chaudes ». Mais les nouveaux états slaves, en particulier la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, étaient bien loin d’être des États nationaux. Comme nombre d’observateurs contemporains l’observèrent (il suffit de citer le Keynes de « Les conséquences économiques de la paix »), les conditions imposées à l’Allemagne, d’autre part, étaient telles qu’elles impliquaient l’impossibilité d’une totale normalisation des rapports entre puissances.
Les effets ne furent pas moins notables dans le champ de la vie sociale : toutes les énergies des différents pays furent jetées dans le conflit, comportant un emploi massif de la propagande et une disciplination de la vie économique sans précédents : le laissez-faire, l’idée que l’État devait se limiter à un benign neglet dans les affrontements entre forces économiques, laissées aux pures lois du marché, laissait désormais place à un dirigisme envahissant.
Pendant que le mouvement ouvrier européen avançait à tâtons, paralysé par l’hypertrophie de « son » parti, seule une fraction du « petit » et peu estimé mouvement russe, qui avait une incomparable tradition de lutte contre le révisionnisme et l’opportunisme, qui s’était forgé, à l’aube du nouveau siècle, au feu de la révolution battue de 1905, et trempé dans les froidures de la déportation, des prisons, de l’exil, ne voulait ni ne pouvait – poussé par la situation explosive de l’Empire Russe semi-féodal – se résigner : « Nous devons rêver ! » hurla Lénine en relevant le drapeau de l’internationalisme et en appelant au rassemblement les gauches qui lui étaient resté fidèles. De l’audace, de l’audace et encore de l’audace. Face aux socialistes ahuris et compassés up to date de Zimmervald les bolchéviques lancèrent le mot d’ordre – se fiant sur l’instinct combatif des masses face au désastre de la « grande guerre » – que l’on devait accomplir les consignes du vieil Engels et recruter tout ce qui était resté de bon dans la vieilles Internationale : « Défaitisme révolutionnaire ! Transformation de la guerre impérialiste en guerre civile ! Fondation d’une nouvelle Internationale ! ».
Alors que les paroles d’Engels avaient semblé vraisemblables à son époque, celles de Lénine furent accueillies avec incrédulité, scepticisme et dérision. Cependant la position de Lénine n’était que le développement de celle d’Engels et, loin d’être le résultat d’une exaltation utopiste, reposait sur l’analyse des phénomènes de la nouvelle phase que, à cheval sur le XIXe et le XXe siècle, le capitalisme avait entrepris : celle de l’impérialisme. Voici comment Lénine en décrivait les caractères saillants :
« 1) La concentration de la production et du capital, qui a atteint un haut degré de développement permettant la création de monopoles ayant une fonction décisive dans la vie économique; 2) La fusion du capital bancaire avec le capital industriel et la formation, sur la base de ce « capital financier », d’une oligarchie financière; 3) La grande importance acquise par l’exportation de capitaux en comparaison aux exportations de marchandises; 4) La naissance d’associations monopolistiques internationales de capitalistes qui se répartissent le monde; 5) La complète répartition des terres entre les plus grandes puissances capitalistes »[19].
« L’impérialisme est le plus haut degré de développement du capitalisme, et n’a été atteint qu’au XXe siècle. Pour le capitalisme [bien avant qu’on ne parle de globalisation, NdR] les vieux états nationaux sont devenus trop étroits […]. De libérateur qu’il était dans la lutte contre le féodalisme, le capitalisme, dans la phase impérialiste, est devenu le plus grand oppresseur des nations. De progressif, le capitalisme est devenu réactionnaire; il a développé à tel point les forces productives que l’humanité doit ou passer au socialisme, ou supporter pour des années, et peut être des décennies, la lutte armée entre les « grandes » puissances pour la conservation artificielle du capitalisme moyennant les colonies, les monopoles, les privilèges et les oppressions nationales de toutes sortes »[20].
Si la trahison de la social-démocratie faisait obstacle à la réalisation de la désormais mûre révolution socialiste, par contre « la situation révolutionnaire objective créée par la guerre […] génère inévitablement un état d’esprit révolutionnaire, trempe et éduque les prolétaires les plus conscients et les meilleurs »[21]. De là la nécessité de ce que la gauche révolutionnaire, restée sur le terrain de l’internationalisme, se réorganise pour recruter sur la base des sentiments révolutionnaires nés de la catastrophe provoquée par le conflit.
Les évolutions successives semblèrent confirmer les espérances du bolchévisme. La révolution russe ouvrait une nouvelle phase montante du mouvement ouvrier, culminant par la fondation de l’Internationale communiste. Les prévisions du vieil Engels semblaient à un pas de l’accomplissement. L’idée centrale qui animait les bolchéviques était celle d’utiliser l’immense écho révolutionnaire émanant d’Octobre pour relancer l’hypothèse de la révolution mondiale, pour unir, comme le disait Lénine, les « deux moitiés dépareillées » du socialisme : la politique, présente en Russie, qui cependant manquait de par son arriération économique des possibilités matérielles de réaliser le socialisme; l’économique, présente en Europe occidentale, capitalistiquement avancée, ou cependant la classe ouvrière et ses avant-gardes combattives se démontraient encore immatures à l’accomplissement des tâches révolutionnaires. Cette union semblait cependant à portée immédiate. On lit dans le « Manifeste du Premier Congrès de la Troisième Internationale », en 1919 :
« Les contradictions du système capitaliste mondial, nichées en son sein même, se libèrent avec la terrible violence d’une énorme explosion : la grande guerre impérialiste mondiale […].La nouvelle époque est née ! C’est l’époque de la désagrégation du capitalisme, de sa dissolution interne, l’époque de la révolution communiste du prolétariat. Le système impérialiste se brise. Fermentation dans les colonies, fermentations dans les petites nations jusqu’alors opprimées, insurrection du prolétariat, révolutions prolétariennes victorieuses dans différents pays, désagrégation des armées impérialistes, totale incapacité des classes dirigeantes à guider le destin des peuples : c’est le cadre de la situation actuelle dans le monde entier.. Sur l’humanité, dont la civilisation a été aujourd’hui abattue, repose la menace d’une destruction totale. Une seule force peut la sauver, et cette force c’est le prolétariat. Le vieil « ordre » capitaliste n’existe plus, ne peut plus exister. Le résultat final du processus productif capitaliste est le chaos, et ce chaos ne peut être dépassé que par la plus grande classe productrice : le prolétariat »[22].
Le Comintern vécut ses deux premières années avec la conviction totale que le capitalisme mondial était désormais irrémédiablement désagrégé et destiné à laisser bien vite la place, au moins dans l’aire européenne, à la domination de la classe ouvrière. À l’épreuve des faits les partis communistes nés des scissions des vieilles organisations social-démocrates se montrèrent peu influents et trop faibles numériquement et théoriquement pour aspirer au pouvoir : les vagues prolétariennes venant de l’exemple russe, des souffrances de la guerre et de la crise capitaliste de la période immédiatement successive, bien qu’impressionnantes et répétées, surtout dans l’aire allemande, furent repoussées. Ceci permit aux pouvoirs bourgeois, un moment vacillants, de se réorganiser, grâce aussi au concours des partis socialistes, dont les représentants freinèrent et désorganisèrent les masses, quand ils ne participèrent pas directement, au gouvernement, à leur répression, comme en Allemagne, ou le gouvernement social-démocrate écrasa le spartakisme et assassina ses chefs.
À partir de 1921, le pouvoir communiste russe et l’Internationale furent contraints de changer de perspective. Le premier se retrouva à faire les comptes avec un pays réduit à la famine et, sous la pression d’une vague de grèves dans les villes et de mouvements dans les campagnes culminant avec la rébellion de Kronstadt, à passer du « communisme de guerre » avec lequel il avait géré l’émergence de la guerre civile, à un projet plus stable de reprise économique. La « Nouvelle Economie Politique », impossible sans un compromis stable avec la majorité paysanne de la population, surgissait en somme aussi de la conscience de l’impossibilité d’une exportation rapide de la révolution en Occident. Le capitalisme, reconnurent les conférences bolchéviques et de l’Internationale, se « stabilisait », c’est à dire promettait de durer encore. « Nous devons savoir résister jusqu’à la prochaine vague révolutionnaire », devrait-on attendre encore « vingt » ou « cinquante » ans, disaient Lénine et Trotski, et employer ce temps, en Union Soviétique, à « construire les bases du socialisme », c’est-à-dire l’industrie capitaliste, et en Occident à « conquérir les masses ».
L’hypothèse que le capitalisme puisse durer encore aussi longtemps était d’autre part purement théorique. Dans les conditions de marasme économique généralisé des premières années vingt, aucun communiste et aucune personne sensée n’aurait pu imaginer que le capitalisme puisse arriver au XXIe siècle. En 1923 encore, l’occupation de la Ruhr et les phénomènes inouïs comme la « grande inflation » (le mark de 1923 valait un million de million de fois moins que dix années avant)[23] semblaient de sûrs indices de l’incapacité du système à mettre un frein à ses propres contradictions, préparant d’autres guerres et d’autres révolutions.
Le système financier international, en particulier, ne put jamais trouver, entre les deux guerres, un équilibre satisfaisant. Son « ubi consistam » avant guerre, le gold standard, s’était démontré inadéquat. La tentative opérée en 1926 pour mettre un peu d’ordre dans le système de change fluctuant à travers le gold exchange standard[24] fut bien vite emportée. Accablée par les prêts contractés avec les USA, Londres tenta désespérément de tenir la prédominance de sa monnaie qui garantissait aux financiers de la City une rente de situation, avec le résultat d’aggraver sa balance commerciale. L’Allemagne de Weimar aussi, relevée grâce aux dollars du plan Dawes, se trouvait à son tour financièrement aux mains de l’oncle Sam[25]. Dans tous les pays capitalistes l’insistance sur le maintien du régime basé sur l’or, une défense à outrance de sa propre monnaie curieusement similaire au monétarisme actuellement inspiré par la Bundesbank à la Banque Centrale Européenne, une dépression des prix agricoles provenant notamment des notables progrès techniques de l’agriculture, contribuèrent à maintenir élevé le niveau de chômage et à poser des obstacles aux investissements.
De toute manière, les buts que les bolchéviques s’étaient fixés se révélèrent inaccessibles. Avant tout la classe ouvrière et les avant-gardes révolutionnaires d’Occident ne se montrèrent pas à la hauteur de la révolution : le poids des traditions démocratiques d’une part, l’influence encore prédominante de la social-démocratie au sein des masses de l’autre, la moindre acuité de la crise par rapport à la Russie pré-révolutionnaire de l’autre encore, posèrent des obstacles irrémédiables aux partis communistes trop peu experts et trop récents. Ruineuse fut surtout la tactique, également voulue par les bolchéviques, qui manœuvraient pour gagner du temps et conquérir « la majorité » de la classe, du front unique politique avec ces mêmes partis socialistes dont on s’était séparé et qui portaient la responsabilité non seulement de nombreuses défaites prolétariennes mais aussi de la répression directe du mouvement ouvrier révolutionnaire et de ses avant-gardes communistes, comme en Allemagne, ou le gouvernement social-démocrate se couvrit du sang de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht.
En second lieu, en Union Soviétique, les forces du marché et du capitalisme, que les bolchéviques entendaient tenir à l’œil sous le fouet d’une dictature de fer, se montrèrent en réalité incontrôlables, engendrant dans le pays un heurt de classes entre la minorité prolétarienne d’un côté, le capitalisme d’état et la majorité petite-bourgeoise de l’autre. Ceci se traduit par une longue et confuse lutte intestine au sein du parti russe résultant, à cheval entre 1926 et 1927, à la victoire de la faction qui représentait les exigences des forces bourgeoises, lesquelles transformèrent le travail pour l’édification des « bases » du socialisme en « construction du socialisme dans un seul pays ». La victoire du stalinisme signifia, en Russie, la liquidation politique et physique de la vieille garde bolchévique et de toute opposition prolétarienne, et au niveau international, la subordination du Comintern aux exigences politiques et diplomatiques de l’État russe. Ceci fut particulièrement évident pendant la longue grève des mineurs anglais de 1926, quand les communistes anglais furent poussés par la direction de l’Internationale à redonner confiance dans la gauche des Trade Unions qui au contraire contribua à enterrer la grève, et en 1927 en Chine, où la ligne de Boukharine-Staline d’entrisme dans le Kouo-min-tang permit à celui-ci de se lancer dans le massacre du prolétariat de Shanghai et dans la persécution des communistes chinois.
En troisième lieu, en particulier aux États-Unis, qui étaient sortis du conflit comme première puissance mondiale, l’économie capitaliste entrait en réalité dans une période de grande expansion, les « années folles ». À la veille de la crise de 1929 la production américaine dépassait de 65 % son niveau de 1913, en 1925 la demande de machines avait cru de 90 %, celle d’équipements métallurgiques de 50 %[26]. Le « consumérisme », favorisé également par l’introduction des ventes à crédit et une publicité désormais martelante[27], avait fait son apparition, justement aux États Unis ou en 1929 il y avait déjà autant de voitures par habitant que dans l’Italie de 1970[28]. La réorganisation du travail industriel, appelée « rationalisation » en Europe et « taylorisme » ou « fordisme » en Amérique, avait conféré à l’industrie moderne sa maturité définitive à travers l’analyse et l’élaboration scientifique du processus de production.
Au sein de l’Internationale les discussions sur le futur du capitalisme avaient été vives. Marx en son temps avait observé que l’économie capitaliste procédait par cycles. Dans chaque cycle se succédaient des phases de « stagnation, de vitalité moyenne, d’accélération (c’est-à-dire de « booms », NdR), de crise »[29], cette dernière « constituant toujours le point de départ de nouveaux larges investissements » et donc, considérant la société dans son ensemble, « une nouvelle base matérielle pour le prochain cycle de rotation ». « On peut supposer – affirmait Marx – que pour les principales branches de l’industrie ce cycle soit désormais (c’est bien le sujet de notre article, NdR) en moyenne de dix ans » et coïncide avec les phases de révolutionnarisation et de substitution de l’économie dues aux nouvelles technologies[30]. Nous avons déjà vu que, lors de la publication du tome III du « Capital », Engels avait observé une variation du rythme des cycles.
Au IIIe Congrès de l’Internationale communiste, qui avait admis l’existence d’une certaine « stabilisation capitaliste », Trotski, citant une analyse du « Times », avait observé l’existence, à côté de cycles brefs, de cycles de plus longue durée du développement capitaliste :
« Dans les périodes de rapide développement capitaliste – avons nous conclu – les crises sont brèves et de caractère superficiel, alors que les booms se prolongent et acquièrent des dimensions considérables. Dans les périodes de déclin capitaliste, les crises sont de caractère prolongé et les booms sont limités, superficiels et de caractère spéculatifs. Dans les périodes de stagnation les fluctuations se produisent à ce même niveau »[31].
« …Nous devons faire une nette distinction - affirme l’année suivante le IVe Congrès – entre deux types de courbe : la courbe de fond qui délimite le développement des forces productives capitalistes, l’augmentation de la productivité du travail, l’accumulation de richesses, etc., et la courbe cyclique que décrivent les vagues périodiques de booms et de crises, qui se répètent, en moyenne, tous les neuf ans. La corrélation entre ces deux courbes n’a pas encore été illustrée dans la théorie marxiste, ni, à ce que le sache, dans la littérature économique en général. Et pourtant il s’agit d’une question de la plus grande importance théorique et politique »[32].
Attirant l’attention sur l’enchevêtrement des ondes cycliques et des ondes longues de la production capitaliste, Trotski reprenait en réalité une suggestion de Parvus accueillie avec beaucoup d’intérêts par Kautsky. En tous cas il s’en servira pour maintenir que, au delà d’une stabilisation partielle, le capitalisme mondial se trouvait dans une phase de déclin et de crise historique.
Quelques années après, Boukharine et Varga, sans s’opposer directement à l’idée de Lénine que la révolution russe avait ouvert la phase de la victoire mondiale du prolétariat, avaient avancé l’hypothèse que la « stabilisation » capitaliste aurait pu être de longue durée, et que celle-ci soit en rapport avec la transformation que les crises capitalistes avaient désormais subies à l’époque de l’impérialisme, perdant leur caractère aigu pour se chroniciser. Cette position servait à ce moment à supporter la théorie de la possibilité de l’édification du socialisme dans la seule Russie, et elle fut pour cette raison fièrement attaquée par l’Opposition de gauche qui voyait à l’opposé dans la « stabilisation » un phénomène temporaire précédant une nouvelle crise révolutionnaire[33]. Les deux fractions étaient dans l’erreur : la crise mondiale était destinée dans un proche avenir à exploser avec une violence encore jamais vue mais sans renouveler la vague de lutte des années précédentes.
L’année fatale 1929, un rapport de la « Commission sur les conditions des changements économiques » présidée par le président Hoover, déclare avec l’emphase caractéristique de la « nouvelle frontière » (« new deal ») :
« … Sur le plan économique s’ouvre devant nous un horizon sans frontières; de nouveaux besoins ouvrent toujours la voie à d’autres, sans limites, au moment même où ils sont satisfaits […]. Disons que nous effleurons à peine les limites de nos propres possibilités de développement »[34].
Il ne faut pas alors s’étonner que la grande crise, qui était à quelques semaines de son éclatement, ait été destinée à laisser dans la mémoire historique de la bourgeoisie et de ses ennemis, les révolutionnaires, une impression jamais égalée[35]. En effet il s’agissait, et il s’agit, de la plus violente et profonde crise jamais traversée par le capitalisme : elle commença par un mémorable crash à la bourse de Wall Street et fut poursuivie par une violente fuite des capitaux réclamés par l’Europe (surtout l’Allemagne) à l’Amérique, et fut une véritable catastrophe productive. En trois ans la production baissa aux USA, pays le plus touché, de 55 %, et dans les autres pays d’un pourcentage variant de 25 à 50 %. La crise fut vraiment mondiale puisqu’elle engloba, là aussi avec des effets désastreux, les colonies. Le commerce mondial chuta de 40 % en valeur, le revenu national de toute une série de pays fut diminué de moitié. Les prix des matières premières baissèrent de 30 à 50 %, celui des produits manufacturés autour de 30 %[36]. Pendant qu’à cause de la déflation le salaire des travailleurs voyait croître son pouvoir d’achat, les masses furent touchées de front par l’extension du chômage : en 1933, moment le plus aigu de la crise, 22 % de la force de travail anglaise et belge, 24 % de la suédoise, 27 % de l’américaine, 29 % de l’autrichienne, 31 % de la norvégienne, 32 % de la danoise, et 44 % de l’allemande étaient sans travail[37].
« Le gigantesque système de crédit que la classe capitaliste avait construit après-guerre – écrit le socialiste autrichien Otto Bauer en 1936 – s’écroula. Le paiement des réparations et des dettes de guerre fut suspendu. Sous forme de pactes de non-intervention, normes monétaires et « moratoires de transferts », les États suspendirent le remboursement des crédits à court terme et le paiement des intérêts ainsi que les versements d’amortissements des dettes extérieures à long terme […]. La réserve d’or de la Banque d’Angleterre fut assaillis, celle-ci suspendit le remboursement en or des billets et en même temps l’émission de monnaie d’or. La voie était désormais tracée : l’un après l’autre les États suspendirent les émissions en or et laissèrent chuter le cours de la monnaie nationale. Alors que peu d’années auparavant la monnaie avait été stabilisée par de graves sacrifices, ce point était le départ d’une nouvelle dévaluation »[38].
On n’avait jamais rien vu de ce genre : la « grande dépression » du dernier quart de siècle précédent, en comparaison, palissait. De la même manière, cependant, la reprise se démontra tardive et incertaine[39]. Il faudra attendre 1937 pour que le niveau de 1929 fût atteint, après quoi la production baissa à nouveau pesamment l’année suivante. Il en fut de même dans presque tous les pays. Toutes les données économiques de la fin de la décade enregistraient déjà la préparation du second conflit mondial, avec l’influence grandissante des commandes d’État. Comme l’observait l’« Economist » juste avant guerre à propos de l’État, « le gendarme s’est transformé en Père Noël »[40].
6 – Stalinisme et « anti-fascisme »
[prev.] [content] [next]
Il n’est pas indifférent que la crise de 29, loin de déterminer une reprise des luttes ouvrières, en ait constitué l’enterrement : rendue exsangue par les défaites précédentes, la classe ouvrière se trouvait située sous l’influence des partis communistes qui n’en avaient plus que le nom, soumis de fait à la politique de l’État « soviétique ». L’imposante machine propagandiste de ce dernier s’appuyant sur la démoralisation d’un mouvement en retrait, a pu pendant des décennies occulter l’authentique cours de la révolution russe et du mouvement ouvrier international : il fallait démontrer que le stalinisme représentait la continuité de « léninisme » et le développement du « socialisme réel ». Ceci nécessitait en même temps une profonde révision historiographique, poussée jusqu’à la construction d’un colossal bluff politico-judiciaire : lors des procès de Moscou dans la seconde moitié des années 30, la vieille garde bolchévique, l’élite révolutionnaire communiste, fut accusée de collusion avec le nazisme, de complots anti-communistes; pire, sous les contraintes physiques et psychologiques ils furent contraints de s’auto accuser de tels délits et exécutés.
Le stalinisme réalisa, en plus de la révision de l’histoire, la perversion du contenu du marxisme : la rageuse et économiquement désastreuse lutte contre l’influence des paysans aisés, la fameuse « dékoulakisation », fut présentée comme une étape de la collectivisation. La laborieuse et difficile implantation en Russie de la production industrielle capitaliste moderne à travers l’usage massif et parfois désastreux des commandes de l’État planificateur fut parée du nom de construction du socialisme. Les plans quinquennaux, annoncés à grands cris et régulièrement non atteints, devinrent les étapes au cours desquelles on scandait, d’une part la progression d’un « communisme » égayé par le travail salarié, l’argent, la misère tout comme le « capitalisme »; de l’autre la course à la production derrière celle de l’Occident qui, selon les dirigeants du Kremlin, devait être atteinte et dépassée, confirmant ainsi la « supériorité » du système soviétique.
Les faits se sont chargés de démontrer à ce moment là que non seulement l’Occident n’était pas rejoint, mais que le tissus productif, social et institutionnel de l’Union Soviétique ait fini par imploser sous la pression d’une compétition perdue au départ dans ce qui a été défini comme l’« écroulement du communisme » et qui a été à l’opposé la faillite d’un capitalisme arriéré érigé « à la cosaque » sous le fouet d’un délire planificateur digne héritier du despotisme oriental, dilapidant à mains ouvertes les ressources humaines et les matières premières, polluant et détruisant pour doter l’appareil productif d’usines coûteuses et anti-économiques, et pour fournir les bases d’ambitions impérialistes d’un appareil militaire démesuré par rapport aux ressources à disposition.
Les aberrations du « socialisme réel » ont comporté la défiguration complète du mouvement ouvrier international et la stérilisation de tout résidu de potentialités classistes. Au cours de la « guerre civile espagnole » le stalinisme, tandis qu’il donnait la preuve de son alignement anti-allemand dans la guerre à venir, non seulement contribuait politiquement à la défaite d’une classe ouvrière réduite au rôle de porte-étendard de la démocratie républicaine, mais contribuait à l’élimination physique de l’avant-garde combattive. Avec la politique des « fronts populaires » d’abord, avec l’apaisement envers l’Allemagne pendant la période du pacte Ribbentrop-Molotov ensuite, la politique de Staline donnait une série de coups de barre avant de se concrétiser, à partir de l’invasion par l’URSS de l’Allemagne durant le second conflit mondial (et pas avant !), dans la participation à la guerre au côté des « alliés ». La « résistance », en particulier, avec son énorme valeur symbolique, pesa comme un cauchemar sur la possibilité de reprise d’un futur mouvement ouvrier réellement autonome : ses poses révolutionnaires et partisanes ont en fait obtenu le résultat d’obscurcir complètement son caractère d’asservissement à une position belliciste impérialiste.
7 – Fascisme et New Deal
[prev.] [content] [next]
Les effets de la grande crise sur la politique économique des États bourgeois avait été la mise au grenier définitive de ce qui restait du libéralisme. Suivant les traces du fascisme italien, les principales nations capitalistes développèrent énormément le rôle de l’État dans l’économie : la politique de deficit spending qui, par un virage à 180 degrés, fut adoptée pour piloter le système hors de la dépression signifia un renforcement jamais vu du pouvoir économique et financier, une stricte symbiose entre celui-ci et le pouvoir d’état, un effort gigantesque de régulation des conflits de classe, d’un côté en érigeant une série de garanties sociales (le welfare state) comme barrière contre les mouvements radicaux, et de l’autre effectuant un stricte contrôle des organisations syndicales, se soumettant leurs directions et les partis ouvriers avec la contre-partie de leur toujours plus étroite intégration dans l’appareil politique et étatique.
L’État bourgeois assumait peu à peu la forme qui le caractérisa surtout après le second conflit mondial et qui restera sienne jusqu’à environ la moitié des années 70. Une forme originale et nouvelle qui intégrait les différentes poussées, dont celles qui dans la période antérieure l’avaient agité de l’intérieur, qui devenaient compatibles avec sa survie après les menaces portées par la succession des luttes ouvrières des années 20 et par la crise : la concentration du pouvoir politique, la répression du mouvement ouvrier, l’utilisation sans préjugés et systématique des moyens de communication de masse, une politique du « consensus » dans laquelle même une pensée hyper-démocratique comme celle de l’« école de Francfort » (Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc.) a réussis à entrevoir la stricte analogie avec le totalitarisme fasciste et nazi.
La compréhension de la nature « fasciste », « étatique » de l’évolution capitaliste depuis la première guerre mondiale et la crise de 1929, la compréhension de la « modernité » du fascisme que l’historiographie la plus récente (par exemple De Felice en Italie, Hillgruber et Zitelmann en Allemagne) a été contrainte de redécouvrir après des décennies de facéties staliniennes et gramscistes[41] sur son caractère « rétrograde » est un des nœuds cruciaux de la compréhension du vingtième siècle. Sans cette compréhension, sans celle, indissolublement liée, de la nature du stalinisme, sans celle, à son tour indissoluble des deux autres, de l’« antifascisme », l’histoire du siècle qui se clôt, à partir du premier après-guerre, devient inévitablement caricaturale : une fois close l’interprétation à la PCUS d’un « camp socialiste » en expansion qui s’allie momentanément avec l’ennemi capitaliste pour combattre la version plus horrible de celui-ci, c’est à dire le nazi-fascisme, avant de reprendre sa « compétition » avec le front occidental, reste celle du monde de la « liberté » et de la « démocratie » qui, dirigée par uncle Sam, vainc l’hydre totalitaire nazi-fasci-communiste pour assurer au monde la paix civile.
« Ce qui est perdu – écrira Pollock en 1933 réfléchissant sur la crise de 29 – ce n’est pas le capitalisme mais sa phase libérale »[42]. Les institutions démocratiques qui avaient caractérisé les révolutions bourgeoises et la période progressive d’implantation des régimes bourgeois perdaient en conséquence, si elles l’avaient jamais eu, le caractère de centre du pouvoir – possédés désormais par les trusts, entreprises d’état monopolistes et lobbies constitués par ceux-ci – se transformant en institutions conservatrices d’acquisition du consensus social, centres de corruption des classes opprimées, s’illusionnant pouvoir aspirer à la cogestion de la société à travers le suffrage universel. Au fur et à mesure que le droit de vote se diffusait dans les pays capitalistes mûrs, abandonnant le caractère censitaire, s’étendant aux femmes, il perdait peu à peu toute incidence décisive sur la vie politique et sociale, alors que toute différence substantielle entre « droite » et « gauche » de l’arc parlementaire se perdait dans la marmelade de programmes interclassistes analogues élaborés dans l’unique but de soutirer des votes à travers des promesses jamais tenues.
Combien de fois dans l’histoire du XXe siècle la classe ouvrière a t'elle sacrifié ses propres intérêts, s’est-elle dépouillée de son opposition intransigeante à l’État bourgeois, a t'elle « suspendu » la lutte anticapitaliste pour « défendre » ou « rétablir » les libertés « démocratiques », c’est à dire les « libertés » acquises les armes en main par la bourgeoisie pour imposer historiquement son propre régime ? Combien de fois (Italie, Allemagne, Espagne dans le Ier après-guerre, Chili, Argentine, etc. dans le second) la « démocratie » a t'elle, avec ses litanies pacifistes et légalistes, désarmé la classe ouvrière face à la réaction fasciste ?
Cependant, lors des débats de la IIIe Internationale sur le fascisme, au début des années 20, on n’avait pas manqué d’interprétations du phénomène qui auraient permis au mouvement ouvrier international d’éviter la descente aux enfers de l’« anti-fascisme » :
« …La bourgeoisie - écrivait la gauche du PCd’I en 1921 dans un article intitulé « Le fascisme » – tendra a pousser au maximum l’intensification des deux méthodes défensives, qui ne sont pas incompatibles mais parallèles. Celle-ci fera ostensiblement la plus audacieuse politique démocratique et social-démocrate pendant qu’elle lâchera les escouades des organisations militaires blanches pour semer la terreur dans les rangs du prolétariat »[43].
« La genèse du fascisme – affirma t'elle au IVe Congrès de l’Internationale communiste en 1922 anticipant de cinquante ans les analyses que nous avons effleuré ci-dessus – doit […] être attribué à trois facteurs principaux : l’État, la grande bourgeoisie et les classes moyennes »[44]
« Le fascisme […] est le parti unitaire, à organisation centralisée et fortement disciplinée, de la bourgeoisie et des classes qui gravitent dans son orbite. C’est l’état bourgeois-démocratique, complétée par une organisation des citoyens […] les méthodes de la violence réactionnaire sont sans ambiguïté combiné à la démagogie démocratique. La confluence avec le réformisme est claire »[45].
Il n’était pas nécessaire d’attendre ce dernier quart de siècle pour découvrir, comme il advient de plus à partir de milieux de droite, que, au même titre que le New Deal qui le suit, le fascisme a réalisé quelques-unes des exigences du socialisme réformiste (sécurité sociale, retraites, travaux publics, etc.) pour s’assurer le « consensus ». Il n’est pas inutile de relever qu’en Allemagne le fascisme s’appellera national-socialisme.
Le fascisme « est un mouvement plus moderne, plus raffiné, qui cherche en même temps à gagner de l’influence dans les masse prolétariennes. Et à cette fin il s’empare sans hésiter des principes de l’organisation syndicale »[46].
« … Le fascisme doit il être considéré comme une victoire de la droite bourgeoise contre la gauche bourgeoise ? Non, le fascisme est quelque chose de plus : il est la synthèse des deux moyens de défense de la classe bourgeoise »[47].
La consigne était claire : aucune alliance avec les désormais anachroniques partis démocratiques contre le « fascisme », aucune nostalgie de la démocratie libérale, mais lutte intransigeante et simultanée contre les deux formes de la politique bourgeoise.
« Il s’agit de résister aux illusions démocratiques sur lesquelles le fascisme joue lui-même (arrivé au pouvoir par la voie parlementaire, NdR), de compter parmi les ennemis les différentes oppositions (démocratiques, NdR) à Sa Majesté, de lutter contre la criminelle illusion pacifiste des (socialistes, NdR) unitaires et maximalistes […]. La démocratie a fait son temps. Les colombes libérales, et de cœur avec eux les aigles qui aujourd’hui montrent ostensiblement un antiparlementarisme bourgeois et réactionnaire (à peu de distance, après l’assassinat de Matteotti, les partis se seront en fait « retiré sur l’Aventin », NdR), crieront bien autrement lorsqu’ils verront comment traite la démocratie une révolution qui ne sera pas d’opérette »[48].
Bien peu furent cependant les communistes qui, forts de cette interprétation, restèrent insensibles aux sirènes « antifascistes » de la guerre civile espagnole et de la « résistance ».
« Notre position face au phénomène du partisianisme – lit-on dans le n° 4 de juin 1944 de « Prometeo », organe de la gauche communiste italienne survivante de la bourrasque stalinienne – est due à de précises raisons de classe. Nées du délabrement de l’armée, les bandes armées sont, objectivement et dans les intentions de leurs animateurs, des instruments du mécanisme de guerre anglais, et les partis démocratiques l’exploitent avec la double intention de reconstruire sur le territoire occupé un potentiel de guerre et de dévier de la lutte de classe une menaçante masse prolétarienne, la jetant dans la fournaise du conflit ».
Le résultat de cet asservissement fut durant le second conflit impérialiste mondial la victoire de l’impérialisme le plus fort et le plus rapace, l’anglo-saxon, sur le plan militaire. La victoire de l’étatisme bourgeois dans ses versions politiquement les plus dangereuses, celles dites « socialistes » et « démocratiques », qui pouvaient ajouter à l’exercice de la force et de la violence de classe, plus que le fascisme et le nazisme, la carte du consensus démocratique et social. Le mouvement ouvrier ne s’est pas encore émancipé de cette double manœuvre. C’est une des clefs de la compréhension de sa progressive atténuation au cours du second après-guerre.
Il suffit d’éteindre le son de la propagande historiographique et d’observer sur l’écran de l’histoire les coalitions de la seconde guerre mondiale pour comprendre la réalité. Guerre des démocraties et du socialisme alliés contre le nazi-fascisme ? Comment alors avant ce que l’histoire considère – ce qui n’est pas la réalité, et en tous cas pas la seule – comme le début du conflit, l’Union Soviétique et l’Allemagne se partagent l’influence au Nord, et qu’à l’Est de l’Europe les coalitions soient encore en grande partie celles de la « grande guerre » ? Pourquoi encore une fois – et encore plus cette fois ci – l’Allemagne se trouve t'elle substantiellement seule face à une coalition dirigée par Londres et Washington ? Pourquoi juste après avoir serré la main de Hitler Staline serre t'il celles de Roosevelt et Churchill ? Pourquoi les manuels font-ils partir la seconde guerre mondiale de l’invasion allemande de la Pologne et non de celle, concomitante, des russes ? Pourquoi la France et la Grande-Bretagne, après la partition de la Pologne, déclarent-ils la guerre aux Allemands et non aux Soviétiques ? Pourquoi à la fin du conflit tous les États européens créés après la première guerre mondiale furent-ils reconnus à l’exception des États baltes (annexés par la Russie) et l’Allemagne, divisée en deux ? La réponse serait embarrassante et est ignorée même de ceux qui, de « gauche », arrivent cependant à dénoncer Dresde rasée jusqu’au sol par les bombardiers alliés ou le « grand soleil d’Hiroshima » comme expressions de l’impérialisme américain mais se gardent bien de prendre position par exemple contre le massacre de Katyn ou 11 000 polonais furent massacrés par l’« armée rouge » parce qu’ils avaient combattus « le mouvement ouvrier international »[49].
La seconde guerre mondiale ne fut pas seulement, et plus que la première, une « guerre totale ». Elle englobe c’est vrai le monde entier : les opérations militaires se déroulèrent sur quatre continents (Europe, Afrique, Asie, Océanie) concernant tous les états. Le nombre de morts est encore le sujet de controverses entre historiens, mais on peut estimer qu’il y a entre trois et cinq fois plus de morts que pendant la guerre de 14–18[50]. La nouveauté de la seconde guerre mondiale n’est donc pas tellement dans le nombre élevé de morts mais dans la proportion de civils parmi eux (plus de la moitié du total)[51] : la terreur systématique lors des confrontations mis en œuvre déportations, lager, bombardements en tapis, armes d’extermination de masse qui deviennent partie intégrante et même prépondérante de la stratégie guerrière. Si les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki causèrent (sans compter les suites) 240 000 morts, pour sa part le bombardement de Dresde, dans l’Allemagne déjà battue, rasa complètement la cité jusqu’au sol et en provoqua 70 000 [En réalité, les raids aériens sur Dresde ont fait entre 21 000 et 25 000 morts. Le chiffre reproduit ici est une relique de la propagande nazie – sinistra.net]. Dans la seule Europe entre 39 et 45, sans compter les juifs et les travailleurs non-allemands en Allemagne, on calcule que le nombre des déportés s’est élevé à près de 40 000 000, auxquels s’ajoutèrent, par la suite, 13 000 000 d’allemands[52]. La guerre du Kosovo n’a sans doute rien inventé ! Et avec tout ceci, la génération du baby boom a été éduquée aux idées hollywoodiennes d’une guerre des bons contre les méchants qui, comme dans le dernier film de Benigni, parlent une langue dure et gutturale.
Du point de vue des rapports inter-impérialistes, le résultat le plus notable du conflit fut en réalité la victoire de ceux qui furent définis comme les deux super-puissances, USA et URSS. Mais alors que la première était vraiment une puissance globale mondiale, soutenue par une économie et une finance leaders du monde, la seconde avait tout au plus une dimension continentale et payait une arriération économique qui ne deviendra claire aux yeux du petit peuple de la gauche que beaucoup plus tard. En tout cas les grands perdant du conflit furent le Japon en Asie et, sur le vieux continent, non seulement une Allemagne réduite et divisée en deux mais l’Europe entière, désormais substantiellement occupée militairement de chaque côté du « rideau de fer » qui finit par diviser les positions orientales et occidentales. Pour cette raison, une lecture de l’après 45 selon les catégories de la « guerre froide », laquelle présuppose deux positions idéologiquement et socialement antithétiques, apparaît insatisfaisant. Si la rivalité russo-américaine pour la prédominance en Europe fut pendant de nombreuses années une donnée indéniable de la géopolitique (tempérée toutefois par l’intérêt réciproque au maintien de la prédominance dans leur sphères d’influence respective), bien moins convaincantes furent les adhésions des états européens à l’OTAN, d’un côté, et de l’autre au Pacte de Varsovie. Pour tous les deux cette adhésion comporta l’alignement sur les décisions des « grands » à Yalta et une notable restriction de la souveraineté nationale[53].
Le 22 juillet 1944, trois jours avant l’offensive finale du général Patton contre les troupes allemandes, les accords de Bretton-Woods signaient, comme le note Keynes, négociateur pour l’Angleterre, la fin officielle de la domination financière anglaise et le début de l’ère du dollar. Avant que les conférences de Yalta et Potsdam, l’année suivante, sanctionnent la répartition géopolitique du monde, la « paix financière » entre les grands du passé, le capital financier anglais désormais vaincu et celui de l’Amérique, triomphateur du siècle, signaient une nouvelle ère : la palme de monnaie internationale d’échange revenait désormais au dollar. Celui-ci était le centre du système de change que, depuis la fin de la guerre, les États Unis cherchèrent à ériger autour de leur monnaie, laquelle – après une tentative ultérieure ratée de la Sterling et une série de lourdes dévaluations (jusqu’à 30 %) des monnaies européennes – resta jusqu’en 1958 la seule convertible en or[54].
De toute manière, le « bloc » occidental put jouir des fruits de l’important financement provenant des États Unis mieux connu sous le nom de « plan Marshall », qui contribua à relever les économies européennes prostrées au bénéfice du capital accumulé par l’Amérique – la seule à ne pas avoir subis de destructions – au cours de la guerre.
Pour les États-Unis, qui à la fin de la guerre représentaient désormais la moitié de la production industrielle mondiale, l’« European recovery programm » (E.R.P) représentait d’un côté le couronnement de sa domination mondiale, de l’autre une nécessité. Nécessité parce que la fin de la guerre avait amorcé un brusque freinage de récession de l’économie américaine, qui avait été le plus grand moteur du conflit. En outre le bilan des paiements des pays européens avec l’Amérique était tellement déficitaire (8 milliards de dollars dont 3,75 dus par la seule Angleterre) qu’on ne pouvait plus penser, dans ces conditions, à une reprise normale des relations économiques mondiales, à laquelle s’opposait entre autre les lourds tarifs douaniers hérités des féroces luttes commerciales qui avaient suivies de près la grande crise de 29 et précédés la guerre. Le plan d’aides à fonds perdus annoncé le 5 juin 1947 par le secrétaire d’État américain George Marshall comportait, jusqu’en 1951, une somme de 13,5 milliards de dollars, après les 11 d’intervention d’urgence émis jusqu’en 1948[55]. Grâce à ceci et aux réductions des tarifs douaniers amorcés par le « General Agreement on Tariffs and Trade » (G.A.T.T.) le système circulatoire du capital mondial put repartir.
Les trois décennies successives, appelées les « trente glorieuses » par Jean Fourastié[56], constituèrent un développement énorme du capital mondial. Entre 1950 et 1973, dans les douze pays de l’« Organisation pour la Coopération et le Développement Economique » (O.C.D.E.), le taux de croissance (voir Tableau 1) fut en moyenne de 4,9 % par an contre 2,9 % par an entre 1900 et 1913 et 2 % par an dans la période 1913–1945, portant le taux de chômage à 3,5 % du total[57]. Le volume du commerce mondial atteint en 1973 500 % de celui précédent celui du « vendredi noir » qui avait brusquement interrompu les « années folles ». La production des biens manufacturiers en 1970 était dix fois plus élevée que celle de 1950 ![58].
Tableau I – Production industrielle des USA – 1985=100
(Source : Supplément à « Il programma communista » 2/97)
[retour au texte]
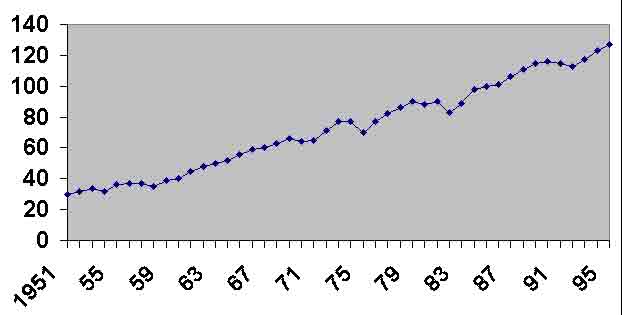
Certes, si on l’analyse en détails, la période ne se démontre pas indemne de ralentissement ou même de récession, mais de faible ampleur et durée. Dans l’ensemble, sans l’ombre d’un doute, la capacité de reprise du capitalisme après la série de grandes dépressions, première guerre mondiale, crise de 29, deuxième guerre mondiale, étonna beaucoup même ses apologistes[59] désormais tous convertis à la doctrine keynésienne d’une incitation au déficit des bilans et prompts à jurer que le welfare state (qui comme nous l’avons dit arriva à pleine réalisation seulement dans le second après-guerre) était une composante essentielle du développement et de la stabilité du système.
Tableau II – Capital fixe par emploi en France.
(P. Villa)
[retour au texte]
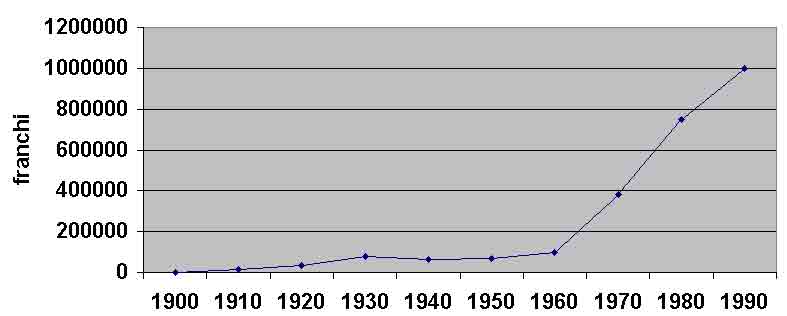
Il était clair qu’une telle vitalité du capitalisme, alimentée par une extraordinaire augmentation de la productivité et du capital constant par rapport au capital variable (Tableau II), pendant que se démentait encore une fois l’optimisme avec lequel les révolutionnaires des années 20 avaient pensé se trouver dans la phase terminale de la vie du régime bourgeois, posait des problèmes non indifférents d’interprétation. Les coryphées du capital avaient-ils donc raison de soutenir que celui-ci était le « meilleur des mondes possibles » ? D’autant plus que celui-ci assurait aussi une amélioration générale des conditions de vie de la classe ouvrière qui n’avait pas de précédents historiques[60] (Tableau III).
Tableau III – Évolution des salaires aux USA en dollars constants 1982
(Source : E. N. Luttwak, 1978)
[retour au texte]
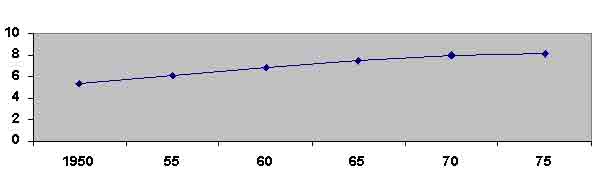
En fait, la vision révolutionnaire restait confinée dans des milieux restreints, confiée à des groupes de survivants de la période de la IIIe Internationale, lesquels, après avoir auguré et aussi crus, encore une fois, que la fin du conflit mondial aurait pu lancer un processus révolutionnaire semblable à celui qui avait suivis la « grande guerre », s’interrogèrent sur la capacité du marxisme à interpréter les phénomènes sociaux de la nouvelle phase capitaliste. Au fur et à mesure que l’on avançait dans l’après-guerre il devenait évident que les explications simplistes de l’« écroulement » du capitalisme avaient fait leur temps : il était par exemple de plus en plus difficile de soutenir, comme Rosa Luxembourg[61], que le capitalisme ne pouvait survivre qu’en s’élargissant vers l’extérieur, détruisant les économies pré capitalistes. Il est vrai que malgré la « décolonisation » de nombreuses aires du monde étaient encore bien loin de la production industrielle moderne, mais il était d’un autre côté vrai que le marché capitaliste s’était au total étendu bien plus en profondeur, à l’intérieur du nombre restreint des métropoles, créant une série de nouveaux besoins, de nouvelles consommations, de nouveaux styles de vie : les 40 millions d’automobiles de 1948 étaient au niveau mondial devenues 250 millions en 1971. En 1946 commençait l’ère de la télévision (les premiers modèles datent de 1933), en 1957 celle du plastique. Les années 40 sont aussi le début des machines à laver. En même temps les progrès en matière médicale (la pénicilline date de 1928) permettaient une augmentation considérable de la vie moyenne (17 ans entre 1930 et 1969)[62], qui s’ajoutaient aux effets du baby boom. En relation avec cette croissance de la « société de consommation », les adolescents devenaient une composante stable du marché, un target, et les jeunes en général un élément essentiel de l’« opinion publique ». Également, l’instruction se « massifiait » et de nouveaux styles de vie, dont témoigne l’énorme consommation de la nouvelle musique de masse urbaine, se répandait.
La structure de la population active s’était radicalement modifiée : désormais dans les grands pays industriels les actifs de l’agriculture étaient descendus sous la barre des 10 %[63], phénomène contrebalancé d’abord par une augmentation des actifs de l’industrie puis d’une extraordinaire augmentation du secteur des services (Tableau IV). Désormais les femmes assumaient un rôle jamais vu dans l’économie (entre 1940 et 1980 les travailleuse américaines passèrent de 14 % à plus de 50 % de la population féminine, à la fin du millénaire elles sont proches de 71 %)[64].
Tableau IV – Employés des services en % de la population active en Japon 1969–1990.
(Source : OCDE 1994)
[retour au texte]
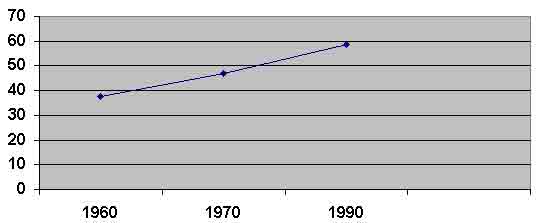
Au total, le second après-guerre vit la puissante affirmation de cette phase de la production capitaliste qui est appelée « taylorisme » ou « fordisme ». Au sens strict, il s’agit de l’analyse minutieuse et scientifique du processus de production industrielle, rendu possible par la mécanisation, concrétisé par les grandes usines et les « chaînes de montage ». Plus largement ce système comportait toute une organisation de la vie sociale qui fut fonctionnel pour ce mode de production. Les grands avantages de l’usine fordiste, pour être maintenus, réclamaient une grande concentration résidentielle de bras disponibles, servis par des transports, des crèches, des cantines pour résoudre quelques-unes des tâches sociales et familiales des ouvriers et synchroniser le temps social à celui de l’utilisation de l’usine. La rigidité des gigantesques usines quant à l’utilisation de la force de travail, qui devait constamment être maintenue à un niveau minimum, nécessitait la création d’une machine d’assistance sociale couvrant la maladie, les accidents et éventuellement le manque temporaire de travail (on pense aux subsides aux chômeurs, et, en Italie, à l’institution de la « Cassa integrazione guadagni » [« Caisse d’intégration des gains », équivalent des ASSEDIC en France]).
De telles transformations, pendant qu’elles confirmaient – comme le marxisme l’avait prédit – l’extension de la condition de travailleur salarié à des couches toujours plus amples de la population, liquidait historiquement les interprétations vulgaires du marxisme, souvent soutenu par ses adversaires, pour leurs propres raisons, c’est à dire pour pouvoir le démentir. Avant tout celle selon laquelle au cours de son évolution le capitalisme aurait accru de manière absolue la misère de la classe travailleuse. En réalité Marx, en formulant sa « loi de la misère croissante » avait entendu démontrer que, bien qu’augmentant en terme absolu historiquement, la consommation, la quote-part des richesses revenant au prolétariat décroissait en comparaison de la richesse générale produite. Misère relative donc, et non absolue, à ne pas comparer avec la marche du profit, lequel tend à son tour à diminuer en pourcentage du capital total, et donc aux valeurs totales produites.
« Là où la production fleurit – écrivaient les communistes révolutionnaires de la gauche en 1951 –, pour les ouvriers travaillants, toute la gamme des mesures réformistes d’assistance et de prévoyance pour le salarié créent un nouveau type de réserves économiques qui représente une petite garantie de patrimoine à perdre, en un certain sens analogue à celle de l’artisan et du petit paysan; le salarié a donc quelque chose à risquer, et ceci (phénomène d’ailleurs déjà vu par Marx, Engels et Lénine pour l’aristocratie ouvrière) le rend hésitant et aussi opportuniste au moment des luttes syndicales et pire de la grève et de la révolte »[65].
La croissance exponentielle du secteur des services, d’autre part, même si ceci ne devient clair pour tous qu’après la récession de 73–75, quand le pourcentage d’employés dans l’industrie sur les employés totaux commença inexorablement à chuter, mettait en question une autre idée vulgaire, l’identification des « cols bleus » avec le prolétariat et la classe ouvrière, à la base de tant d’ouvriérismes. Il devenait inévitable de reconnaître que ce ne sont plus désormais uniquement dans les chemins de fer et dans les postes mais dans les hôpitaux, les écoles, les supermarchés, les crèches que croissaient des catégories de travailleurs qui, même si ils n’étaient pas directement productifs, concourraient cependant à la valorisation du capital et étaient rémunérés sur la base de la même loi du salaire qui présidait au calcul de la force de travail productive. Ceux-ci appartenaient donc par tous leurs effets à la classe ouvrière, ce qui fut ponctuellement démontré, au cours des années 60 et 70, par leur entrée dans le champ des luttes syndicales, parfois plus âpres que celles des entreprises industrielles, ou la plus forte tradition syndicale permettait un plus stricte contrôle des conflits de la part des syndicats traditionnels, domestiqués par le régime et même toujours plus intégrés, suivant le modèle fasciste, à l’appareil d’état, ou suivant le modèle social-démocrate, insérés dans un système de « cogestion » de l’entreprise.
Etait aussi évidemment discutée la vision d’un capitalisme destiné à mourir suite à la « chronicisation » de ses tendances à la crise[66], ou celle de l’« écroulement » absolu du capitalisme provenant de la chute du taux de profit poussée à fond par l’impossibilité d’assurer la valorisation du capital accumulé (ainsi que, par exemple, l’avait formulé Grossmann[67] à la veille du « vendredi noir »). L’unique possibilité théorique de le maintenir sur pied consistait à retenir que le capitalisme ait été en mesure de connaître une nouvelle période dorée du seul fait des deux guerres mondiales rapprochées : selon cette hypothèse les destructions de guerre auraient temporairement éloigné le fatal déclin « chronique » ou l’« écroulement subit » du capitalisme. Mais inévitablement, une fois sortis des effets de la guerre, le problème se serait à nouveau posé. La discussion était de toute façon, dans l’attente d’une nouvelle crise capitaliste, destinée à continuer.
Au cours des débats internes de l’I.C. dans les années 20, un économiste soviétique, Kondratiev, tombé ensuite en disgrâce pendant la période stalinienne, avait approfondis l’étude historique des cycles, arrivant à confirmer l’existence de cycles longs (ou « ondes ») de l’économie mondiale capitaliste[68], d’une durée de 50 à 60 ans. Plus que sur des éléments théoriques les recherches de Kondratiev se basaient sur des éléments empiriques et, mal perçues en Russie où elles se heurtaient avec l’idée d’un capitalisme entré dans un état de coma sans retour, furent par contre reprises de suite par des économistes bourgeois tel que Schumpeter[69] à la fin des années 30. Parmi les critiques de la théorie des « cycles » on peut signaler la présence de Trotski.
« Un ‹ cycle › – avait-il observé – signifie des fluctuations à l’intérieur d’un système essentiellement inchangé, alors que dans le cas que nous considérons toute nouvelle vague de changements techniques se résout par un déplacement du système économique vers un nouveau stade, qualitativement différent, d’organisation et de techniques, qui comporte un certain nombre de changement socio-économiques. Les ondes du progrès technique – que comme on l’a vu Trotski avait signalé aux IIIe et IVe Congrès du Comintern – doivent donc être interprétées non comme des cycles mais comme des phases d’un processus historique réversible de développement des forces productives chaotique et accompagné de crises »[70].
Quoi qu’il en soit, l’idée que – au delà des hauts et des bas de courte durée de la conjoncture – la production capitaliste traversait de longues périodes de croissance se terminant par de plus ou moins longues et profondes périodes de dépressions fournissait le matériel aux peu d’avant-gardes révolutionnaires restantes permettant de continuer la réflexion théorique qui avait été dans le Comintern non-stalinisé un instrument aux nombreux avantages : en attendant elle permettait – sans pour autant passer sous les fourches caudines de ceux qui pariaient sur l’éternité du capitalisme – de dépasser l’impasse ou aurait mené le fait de continuer à soutenir, contre toute évidence, que la révolution russe aurait ouvert la crise finale du capitalisme. Faute de meilleurs outils, l’existence des « cycles » fournissait en outre une base de prévisions sur la durée de la nouvelle phase d’expansion du capital qui marchait de façon déterminée, traçant les contours, à terme, d’une phase ultérieure de la « crise historique » capitaliste, en plus de la conviction que les contradictions capitalistes y auraient fatalement porté.
Reprenant et ré élaborant, parfois jusqu’à en bouleverser les résultats, le travail des économistes soviétiques Kuczynski et Varga, les communistes italiens de gauche, expulsés du PCI à la fin des années 20, donnèrent aux « cycles longs » de l’économie bourgeoise une interprétation qui semblait tenir compte (qu’elles fussent connues ou non) des objections de Trotski. Sans avancer une théorie des cycles, mais plutôt en se basant sur « une formule empirique […] au plus haut degré », on calculait la possibilité d’une inversion critique du cycle d’expansion capitaliste vers la moitié des années 70[71]. Sur la base des expériences de la fin du XIXe siècle et de la première moitié de XXe, ou l’on avait assisté à une succession de longues dépressions suivies de manière plus ou moins rapprochée de guerres mondiales dévastatrices, il était logique de déduire qu’« une troisième guerre mondiale viendrait après le passage d’une crise majeure d’entre guerre de la portée de celle de 1929–32 »[72]. L’intervalle entre la crise et la guerre aurait permis de mesurer la capacité de la classe ouvrière internationale à assumer son initiative révolutionnaire.
Il est important de souligner qu’il s’agissait d’une position à contre-courant. D’une part celle-ci se portait contre la propagande bourgeoise et sa prétention d’en avoir fini une fois pour toutes avec les contradictions du capitalisme, d’autre part ils abordaient de front l’illusion – amplifiée démesurément par la propagande du « socialisme réel » et reprises par de nombreuses minorités soit-disant révolutionnaires, qu’elles soient trotskistes, « marxistes-léninistes » ou « tiers-mondistes » – que malgré tout la crise capitaliste était en cours, position marquée par l’incessante avancée du socialisme « national » dans tel ou tel pays. Elle prenait donc acte de la persistance du capitalisme, expliquait par celle-ci la déficience manifeste de la lutte prolétarienne internationale, l’incapacité de la classe à se soustraire à l’influence de l’opportunisme stalinien. Elle avait aussi le courage d’affirmer, contre tout activisme et toute illusion de succès à brève échéance, que le communisme révolutionnaire serait encore pour longtemps condamné à une situation de substantiel isolement. Elle pronostiquait cependant en même temps l’inévitabilité de la future crise capitaliste, s’efforçant d’en encadrer le développement dans le temps.
Malgré l’extraordinaire floraison économique de ce qu’Hobsbawm a appelé « les années d’or », les contradictions sociales du capitalisme étaient affaiblies mais non éteintes. Pendant que dans les ghettos américains se développait un mouvement des minorités noires, les grands changements sociaux amorcés par ces développements explosaient vers la fin des années 60 en mouvements particuliers : les étudiants et les jeunes américains donnèrent le signal de départ à un mouvement international qui synthétisait une série de poussées sociales et culturelles : l’opposition à la guerre du Vietnam, une critique des valeurs traditionnelles de la société et de la culture occidentale (l’american way of life), la revendication de l’extension et de l’allongement du droit à l’instruction, de l’égalité entre races et sexes, une réaction contre la déqualification des titres universitaires et du travail intellectuel, une vague sympathie pour les révolutions anti-impérialistes.
Dans l’ensemble ces revendications et ces mouvements, même quand il faisaient usage des armes ou d’une phraséologie empruntée à la tradition du mouvement ouvrier, restaient sur le terrain d’une radicalisation démocratique compatible et même utile à une société capitaliste mûre, avec ses besoins d’extension de l’instruction, de libre exploitation de la force de travail indépendamment des races ou des sexes, donc dans un cadre d’égalité juridique. Et en effet le mouvement, même si il n’a pas fait la « révolution » comme il prétendait vouloir la faire, a indubitablement accompli une partie de ses propres objectifs : élargissement de l’instruction, accès des classes moyennes instruites à certaines fonctions dans le domaine de l’éducation, de la politique, du journalisme, élimination des résidus de législation racistes, réforme du code de la famille, amélioration générale de la situation des femmes. Dans ces limites, les accusations d’aujourd’hui contre les leaders de ces mouvements les accusant d’avoir renié leur passé pour s’insérer aux leviers de commande du système, bien que suggestives, ne correspondent pas à la réalité dans la mesure où dès le départ, au delà de ce que les protagonistes pensaient d’eux-mêmes, le mouvement était de caractère bourgeois, ou plutôt petit-bourgeois.
Le mécontentement des classes moyennes dans le capitalisme mûr aurait pu, dans d’autres circonstances historiques (bien différentes de celle des économies arriérées, ou elles sont propriétaires – comme le paysan et l’artisan – de leurs moyens de production), en partie seconder le mouvement social général de la classe ouvrière. En fait, par certains aspects, comme la sous-traitance, la perception d’un salaire, la prolétarisation latente, etc., ces couches intermédiaires de la société capitaliste mûre non seulement « copient » les formes de lutte de la classe révolutionnaire, mais pourraient, surtout aux niveaux les plus bas, en partager certaines revendications. Au contraire les couches les plus élevées des classes moyennes, ou celles directement liées à des formes parasitaires de revenu (propriétés immobilières, titres, etc.) représentent une notable force contre-révolutionnaire. Oscillant entre ces deux extrêmes la lutte des classes moyennes aujourd’hui finit inévitablement par s’orienter vers la classe la plus forte et la plus solide du moment historique en cours. Les limites montrées dans les années 60 et 70 par le mouvement de la classe ouvrière comportèrent pour cette raison la réabsorption de ce qui fut appelé « les années soixante-huit ».
Quelle fut donc la nature du mouvement ouvrier de ces années ? A cheval entre les années 60 et 70 un réveil notable des luttes ouvrières, bien que de caractère essentiellement trade-unioniste et sans jamais s’échapper substantiellement du contrôle des organisations syndicales intégrées à l’état et de celle des partis ouvriers traditionnels, représenta un phénomène historiquement important qui intéressa une large partie de l’Europe. Selon le studieux anglais R. Lumley, par exemple, la grève générale de mai 68 en France fut la première mobilisation ouvrière de l’histoire en nombre d’heures de travail, alors que l’« automne chaud » de 69 en Italie en fut le troisième, juste après la grève générale de 1926 en Grande-Bretagne[73]. La lutte de la classe ouvrière occidentale de ces années, pendant qu’elle démentissait l’illusion que le capitalisme puisse assurer une paix sociale durable, et sonnait la confirmation de l’inéluctabilité future du choc entre travail salarié et capital, permettait au prolétariat d’accéder pour son propre compte à une partie du progrès social et de la richesse générale, complétant disons « par le bas » les facteurs constitutifs de la société fordiste, et consolidant les conditions de vie désormais considérées comme typiques du prolétariat occidental et auxquelles il a paru pendant de nombreuses années qu’il était impossible de renoncer, et qui apparaissent toujours aujourd’hui comme les uniques dignes, c’est-à-dire la garantie de l’emploi, les lois de garantie des droits syndicaux, les salaires relativement élevés, l’assistance médicale et les congés payés, la journée de travail de 8 heures par jour, etc.
L’âpreté des chocs contre les vieilles formes du pouvoir et de la culture bourgeoise d’un côté, et contre le patronat de l’autre, permirent ici où là la récupération ou le maintient minoritaire d’un lien avec les expériences révolutionnaires passées du mouvement ouvrier, mais en substance les mouvements sociaux des années 60 et 70 finirent par favoriser le remplacement des dirigeants politiques et syndicaux, une capacité supérieure du système à gérer « démocratiquement » le pouvoir, une modernisation de la société bourgeoise telle qu’elle l’a rendu définitivement mûre. Si un vert comme Rutelli peut gérer l’horreur du Jubilée et si les radicaux proposent un référendum contre le Statut des travailleurs, si Blair propose d’en finir avec les indemnités de chômage et si un Président américain se laisse surprendre à fumer le cigare avec une stagiaire et maintient son siège, n’avons-nous pas là la « fantaisie au pouvoir » ?
Il est vrai d’autre part que, dépassant les directions syndicales et politiques opportunistes, les travailleurs donnèrent vie à des formes d’organisation spécifiques, tel que les conseils d’usine qui, étant l’expression historiquement la plus proche de nous de la capacité d’auto-organisation ouvrière, méritent d’être étudiés, au moins parce qu’ils ont montrés les carences que la rupture du fil de la tradition de classe réalisée par le stalinisme comportera de manière encore plus forte – vue le temps passé encore depuis – dans le futur mouvement. Ce n’est donc pas un hasard si ceux-ci ont montré des caractères spontanéistes et ouvriéristes, confondant la lutte contre les partis et syndicats opportunistes avec la lutte contre les partis et les syndicats tout court, reprenant en ceci, dans un contexte d’absence de l’organisation politique révolutionnaire de classe, les vieilles suggestions de l’anarcho-syndicalisme du début du siècle et du conseillisme dans les années 20.
Une autre leçon intéressante de cette période est la capacité de récupération montrée alors par les syndicats officiels qui, justement grâce à ces mouvements qui les remirent en question, surent régénérer leurs propres structures bureaucratiques et rénover les directions. Même si cet aspect – étant donné la disparition actuelle de la vie syndicale – pourrait ne pas avoir la même importance dans le futur, certains signaux (par ex. la lutte de l’UPS, dont nous parlerons par ailleurs, ou celle des cheminots en France en 1995) ne permettent pas de l’exclure.
Certes le radicalisme politique de la fin des années 60 est toujours resté un phénomène minoritaire. Celui-ci ne fut toutefois pas marginal, et une partie non négligeable des prolétaires et des jeunes étaient alors fermement convaincus se trouver à la veille d’une révolution collectiviste. La moindre raison de cette illusion ne fut pas l’impact psychologique et culturel des mouvements de libération nationale sur l’histoire du XXe siècle.
L’idée qu’au-delà de succès apparents ou temporaires le régime capitaliste mondial fut en réalité dans une situation critique, un « tigre de papier », ne venait en fait pas seulement d’une répétition stérile des positions de Lénine dans les années 20, mais aussi de l’incompréhension du cours réel de la révolution russe, c’est-à-dire de l’impossibilité pour un pays arriéré comme la Russie d’accéder de manière isolée au socialisme, en dehors d’un processus révolutionnaire international avorté en 1927.
On a déjà expliqué comment la soumission des partis communistes au stalinisme avait entraîné le désastre pour le mouvement ouvrier occidental. Les effets de celle-ci ne furent pas moins pernicieux envers les mouvements nationaux et anti-impérialistes qui, surtout dans le second après-guerre, donnèrent vie à un des phénomènes sûrement les plus importants du siècle, la « décolonisation ».
Dans la vision de Lénine et du IIe Congrès de l’Internationale Communiste, les mouvements nationaux-révolutionnaires des colonies et semi-colonies devaient être les alliés naturels du prolétariat occidental dans la lutte contre l’impérialisme mondial. La classe ouvrière, en tant que pointe avancée de cette lutte, pausait aussi sa propre candidature à leurs directions : dans les pays avancés en luttant pour le pouvoir prolétarien et contre la politique impérialiste de sa propre bourgeoisie, dans les pays arriérés en combattant avec les révolutionnaires bourgeois contre le despotisme pré-capitaliste et le colonialisme, pour la révolution démocratique, et, si possible, pour la révolution ouvrière et paysanne. Unissant ses efforts à ceux des pays avancés en marche vers le socialisme les pays arriérés auraient pu aussi espérer un dépassement rapide de la phase capitaliste.
Les conditions de cette audacieuse vision stratégique étaient d’un côté qu’on ne donne pas un brevet de communisme aux mouvements démocratiques et anti-impérialistes des pays arriérés et de l’autre que la minorité prolétarienne de ces pays maintienne – comme ça avait été le cas en Russie, et non en Chine – sa propre totale indépendance, prompte à retourner ses armes contre les révolutionnaires bourgeois dès que les objectifs communs étaient atteints.
Au contraire, les mouvements anti-impérialistes qui – de la Chine à Cuba, à l’Indonésie, au Vietnam, au Moyen-Orient, à l’Afrique – ont marqué l’histoire de ce second après-guerre, alors qu’ils étaient privés de la possibilité d’un cours radical à la Lénine de par l’influence du stalinisme, ornaient les processus démocratique-bourgeois modérés d’icônes et de mythes « socialistes » sui generis, les ajoutant au colossal qui pro quo du socialisme soviétique.
Malgré ceci ces mouvements constituaient le phénomène peut-être le plus révolutionnaire du XXe siècle : ceux-ci ont ouvert la route dans des aires jusqu’alors immobiles, non vers le communisme, mais bien vers la société capitaliste et la lutte de classe moderne. Ce n’est donc peut-être pas un blasphème que les héros de ces révolutions bourgeoises, les Robespierre, Napoléon et Garibaldi de ce siècle, c’est à dire les Mao, les Che et les Ho Chi Minh aient trouvé leur digne consécration épique (avec James Dean, Marylin Monroe ou Marlon Brando) dans les œuvres provocatrices d’Andy Warhol et… sur les T-shirt ou les bouteilles de coca (cola) des jeunes du monde entier.
Le 15 août 1971 le Président américain Nixon informait le Fonds Monétaire Européen, créé sous la direction américaine parallèlement aux accords de Bretton-Woods, de la fin de la convertibilité du dollar en or. Il n’est pas excessif d’affirmer qu’il s’agissait d’une décision marquant l’époque. Avec cette décision se concluait définitivement une phase de l’histoire de la monnaie initiée il y a de nombreux siècles, quand celle-ci était née comme marchandise (or, argent, etc.), dotée de valeur intrinsèque à côté des autres marchandises. Si le capitalisme avait dû utiliser les doublons sonnants, si pour mobiliser les immenses quantités de marchandises produites il avait dû immobiliser une valeur correspondante en or, l’Hôtel des Monnaies et l’industrie des coffres-forts seraient les secteurs moteurs de l’économie et emploieraient plus de salariés que l’industrie automobile, et les coûts auraient été intolérables pour le système. Pour se développer, pour libérer la production volcanique des marchandises et le marché sur lequel elles s’échangent des fers de la monnaie « forte » (opération coûteuse, désordonnée et jamais suffisamment élastique et calibrée aux besoins du cycle), le capitalisme à invariablement procédé, avec des hauts et des bas mais invariablement, à la « dématérialisation » de l’argent.
À cette fin il a développé la plus puissante de ses armes de compensation de la disproportion permanente existante sur le marché : le crédit, grâce auquel, comme par miracle, demande et offre peuvent invariablement se rencontrer, rester en apparent équilibre (tu n’as pas d’argent, ton travail n’a pas encore produit les richesses que tu veux consommer ? Achète à crédit !). Grâce au crédit, il est possible que le marais du marché absorbe le volcan de la production. Grâce au crédit, l’État, les banques, les industries ne tombent jamais en faillite. Grâce à celui-ci la surproduction de marchandises d’un côté et de capitaux de l’autre s’annulent réciproquement. Au moins tant… qu’il y a du crédit.
La beauté du crédit est qu’il ne coûte rien dans l’immédiat. À terme il oblige cependant à payer un intérêt. Mais son côté brutal est que quand l’intérêt versé ne compense pas le risque de perdre le capital le crédit disparaît. C’est alors que l’on découvre qu’il y a trop de marchandises d’un côté et trop de capitaux de l’autre… C’est l’histoire des « grandes dépressions » de la fin du XIXe comme de celle de 1929 : à un certain point la bulle du crédit, qui s’auto-alimente, éclate, et le roi est nu.
Celui qui a un compte en banque sait que le lieu sacré du crédit est celui ou, simultanément, on apporte et on prend l’argent. Même les enfants savent que si les chèques avec lesquels on paye la TV ou la machine à laver étaient des bout de papier au lieu d’être émis par une banque, ils ne vaudraient rien. Si je porte 1000 lires en banque la banque me l’inscrit sur un compte et à la fin de l’année il sera écrit sur le compte que le possède 1100 lires. En fait les 1000 lires ont été prêtées à un autre et sont devenues 2000 sans qu’aucune marchandise réelle n’ait été produite. Si il s’agit de la Banque centrale d’un État on peut multiplier l’opération de nombreuses fois. Tant que l’on profite du crédit on peut en faire. Les États-Unis, en vertu des accords de Bretton-Woods, disposent de crédits dans le monde entier. Qu’en ont-ils fait ? Ce que n’importe quel banquier aurait fait à leur place. Profiter du crédit pour multiplier à l’infini les 1000 lires. Ils fabriquèrent bien plus de dollars que ce qui aurait pu être transformé en or sur la base des réserves déposées à Fort Knox.
À la fin des années 60, annoncée par une série de turbulences monétaires (en 1967 il y eut une mémorable dévaluation de la livre anglaise), la situation se dégrada : aussi grand que fut le crédit dont jouissaient les États-Unis, leur poids dans l’économie et le commerce mondial n’étant plus ce qu’ils étaient. Pendant que le premier était désormais passé d’un peu moins de la moitié à un peu plus d’un quart, les exportations de biens manufacturés avaient baissé de 34 % en 1960 à 19 % en 1970, pendant que les exportations de la CEE valaient désormais trois fois celles des USA[74]. Leurs réserves en or s’épuisaient rapidement. Les bouts de papier sans valeur intrinsèque avec lesquels ils avaient inondé le monde, financé l’économie européenne et japonaise, la guerre de Corée et du Viêt-Nam ainsi qu’un déficit croissant de leur balance des paiements finirent par se répercuter sur la balance commerciale, faisant de l’économie américaine une économie en partie de rentiers qui consomment beaucoup plus que ce qu’ils produisent. Comment ? Payant à crédit sans plus de garanties les marchandises acquises. Il était clair qu’un tel système ne pouvait fonctionner à l’infini.
« Le changement intervint dans les cruciales années 1968–1973. Ce fut lors de ces années que les dépôts sur le marché de l’eurodollar et des eurodevises enregistrèrent un bond improvisé vers le haut suivis de vingt années de croissance explosive. Et ce fut au cours de ces mêmes six années que le système des parités fixes entre les principales monnaies nationales et le dollar américain et entre le dollar américain et l’or […] fut abandonné en faveur du système de change flexible ou fluctuant […]. D’un côté l’accumulation d’une masse croissante de liquidités mondiales en dépôts que nul gouvernement ne contrôlait suscita des pressions croissantes afin que les gouvernements jouent sur les taux de change des monnaies respectives et les taux d’intérêt, de manière à attirer ou repousser les liquidités détenues par les marchés offshore pour s’opposer aux carences ou aux excès de leurs économies internes. D’un autre côté, les continuelles variations de change entre les principales monnaies nationales et les différences de taux d’intérêts multiplièrent les opportunités à disposition des capitaux déposés dans les marchés monétaires offshore de se répandre grâce aux transactions et aux spéculations en devise. Comme conséquence de ces développements se développant réciproquement, au milieu des années 70 le volume des transactions purement monétaires réalisées par les marchés offshore dépassait déjà de plusieurs fois la valeur du commerce mondial. Depuis l’expansion financière se poursuit sans freins. Selon une estimation, en 1979 le commerce des devises étrangères se montait à 17,5 trillions de dollars, plus de onze fois la valeur totale du commerce international (1,5 trillions de dollars) »[75].
Les USA furent en somme contraints à couper court aux pressions sur leur monnaie par un simple coup de force. Vous avez voulu des dollars ? Et bien pédalez ! En l’absence d’une devise capable de se substituer au dollar, c’est-à-dire en l’absence d’une devise qui jouisse de plus de crédit qu’un dollar dévalorisé et inconvertible, le monde fut contraint d’avaler la couleuvre, de remplir ses poches avec désolation des dollars amassés, en espérant, sous peine de ruine, que l’on continue à croire en lui. Depuis toute l’économie mondiale travaille sur le crédit pur en sachant que les coffres des banques centrales ne contiennent plus que des chiffons de papier.
Du point de vue phénoménal les eurodollars correspondent aux dépôts des sociétés américaines (les soi-disant « multinationales ») à l’étranger et aux émissions de bons avec lesquels le trésor américain finance le déficit de la balance des paiements. Du point de vue substantiel toutefois, cet excès d’argent était l’indice que quelque chose entravait l’économie capitaliste mondiale après les années du « boom économique », qu’il y avait pléthore de liquidités qui, au lieu d’être investies dans la production, servaient à alimenter la spéculation et la consommation parasitaire. Pour l’analyse marxiste, une telle pléthore de capitaux est la manifestation d’une suraccumulation, d’une surproduction alimentés grâce à l’expansion du crédit, d’une surproduction provenant, en dernière analyse, des difficultés du capital liquide à trouver un emploi profitable : en un mot, en une inflexion de la courbe du taux de profit.
Dans l’immédiat, le « pur dollar standard » donnait aux USA un avantage considérable, l’émancipant de la nécessité d’équilibrer sa propre balance des paiements. À terme néanmoins ceci aggravait les maux des déficits de la balance commerciale et de la balance des paiements américaines.
En 1972 encore, un rapport de l’ONU confiait que « on ne peut prévoir actuellement un phénomène particulier qui puisse influer sur le contexte opérationnel de l’économie européenne en en entraînant une mutation drastique »[76]. Encore une fois la bourgeoisie marchait avec inconscience vers la crise.
Cette dernière – confirmant en un certain sens les prévisions sur les cycles longs avancées par les communistes révolutionnaires de la gauche – toucha lourdement la plupart des pays capitalistes à partir de 1973 et la totalité à partir de 1975. Elle fut précédée, il est vrai, comme beaucoup d’auteurs l’ont noté, aussi bien par la hausse du prix des matières premières (en particulier du pétrole, dont le prix, qui avait déjà doublé les trois années précédentes, suite aux décisions prises par les producteurs arabes en rapport avec la guerre du Kippour puis la guerre Iran-Irak, passa de 1973 à 1981 de deux à quarante dollars le baril[77]), que par une augmentation notable des salaires. De tels facteurs peuvent aussi être mis en rapport avec un phénomène de suraccumulation, le paroxysme précédent la crise bien décrit par Marx. Dans l’ensemble, à partir de la crise monétaire (c’est à dire une crise du crédit), les faits signent indubitablement un retournement de l’économie mondiale et de la société capitaliste mondiale. Comme le dit J. K. Galbraith, « l’âge de l’incertitude » commence.
Pendant que la production des principaux pays capitalistes baissaient de 10 à 20 %, amorçant la plus grave récession de l’après-guerre, un phénomène nouveau s’établit : la présence simultanée de récession et d’inflation : ce fait servit à démentir que les politiques keynésiennes, c’est à dire les commandes d’état, le déficit des bilans, l’émission de billets fussent en soi suffisantes pour éviter le retour du capitalisme à la dépression. De la même manière que la crise de 1929 avait démenti les défenseurs de la stabilité de la monnaie et des changes, celle de 1973–75 a démontré que les récessions ne peuvent pas non plus être expliquées par le manque de crédits, de liquidités ou de dépenses. Même si peu s’en sont aperçus, le débat entre monétaristes et keynésiens est définitivement clos : ils ont tort tous les deux. Comme le dit Marx, la vraie limite du capital, c’est le capital lui-même.
La crise du capitalisme a donc réapparue, démentissant les hypothèses d’une sortie définitive du capitalisme du cycle des conjonctures. Celle-ci n’eut toutefois pas l’ampleur de celle de 1929, et ce fut un des motifs pour lesquels, contrairement à ce que les révolutionnaires avaient espérés, il n’y eut pas de manifestation de reprise de la lutte de classe.
Mais ce ne fut pas l’unique, dans la mesure ou la classe ouvrière occidentale affronta la crise encadrée par des organisations qui d’une part avaient une longue tradition de collaboration avec l’état bourgeois et de l’autre, au cours de la vague trade-unioniste des années précédentes, avaient acquis une crédibilité et un renforcement considérables. Trahie par ses propres dirigeants la classe ouvrière occidentale marcha vers quelques graves défaites, comme celle des contrôleurs aériens américains et des ouvriers de la FIAT en Italie en 1981, et celle des mineurs anglais en 1984. À son tour, dans les pays de l’Est européen, cette fois inclus dans la crise générale (Pologne 1980, mineurs roumains, etc.), où de longues années de « socialisme réel » avaient fait surgir une aversion radicale aux idées même de « lutte de classe » et de « communisme », le mécontentement social se dirigea vers la revendication de l’accès au paradis de la civilisation occidentale. Si c’était le socialisme, autant adopter le capitalisme…
Les conséquences de cette crise ont été d’une énorme importance : avant tout la fin du « plein emploi » (Tableau V). Depuis lors un taux de chômage élevé, particulièrement parmi les jeunes, comme dans l’entre-deux guerres mais à un niveau encore plus élevé, est devenu un élément structurel des économies capitalistes évoluées, qui seulement aux USA, et dans la période la plus récente, a donné des signes, très contradictoires, de réversibilité.
Tableau V – Chômeurs dans l’OCDE en millions.
(Source : OCDE)
[retour au texte]
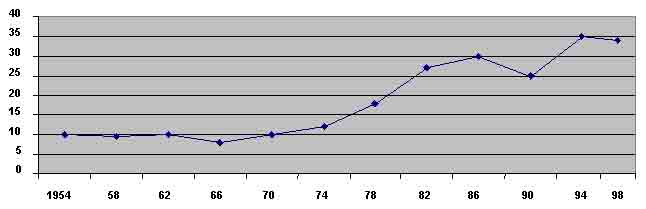
Il faut dire que beaucoup l’attribuent, plus qu’à une tendance intrinsèque de l’évolution du capitalisme de la fin du siècle, au monétarisme ressuscité des gouvernements occidentaux des deux dernières décennies. L’inflation à deux chiffres qui avait caractérisé les années 70 avait en fait entraîné un renversement des politiques keynésiennes en ce qui concerne les devises et les défenses publiques pour les services sociaux. Avec l’arrivée de Thatcher (1979) et de Reagan (1980) à la tête des gouvernements anglais et américains, même si le soutien financier de l’économie restait fort, le monétarisme devenait de nouveau, comme au temps de Montagu Norman, la doctrine officielle du capitalisme. Une fois abandonnée la politique de sous-évaluation du dollar destinée à soutenir les exportations, le taux d’intérêt américain fut porté de 1,72 % en 1980 à 15 % en 1981, avec pour résultat que le taux de change du dollar doubla par rapport au mark allemand, contribuant à une nouvelle « mini » récession économique en 1982. Cette même année la crise financière s’abattit de nouveau sur les marchés sous la forme de l’impossibilité pour de nombreux pays du tiers-monde, en particulier de l’Europe de l’Est et de l’Amérique Latine, de faire face aux énormes déficits accumulés (en dollars désormais réévalué) envers les pays créditeurs. Ceci entraîna un affaiblissement des comptes des banques américaines et entraîna la faillite de certaines d’entre elles. Pour un moment, le monde semble à l’orée d’une crise bancaire catastrophique. « Toute crise financière – reconnaît Soros – est en fait précédée par une extension du crédit jusqu’à des limites insoutenables »[78]. La politique financière keynésienne de l’époque Carter avait approché l’infarctus.
Pour ne pas étrangler l’activité économique, la recette fut : diminution des dépenses publiques, particulièrement de celles dédiées au welfare state, détaxation des revenus élevés et des capitaux, deregulation des mouvements de ces derniers. Les stimulations de la demande ainsi créées se concrétisèrent par un énorme déficit de la balance commerciale américaine, qui correspondait cependant à un solde positif de la balance des paiements à cause des capitaux attirés sur les places financières yankees par la rémunération élevée des bonds américains, et une croissance exponentielle du commerce des titres, tant obligations qu’actions. De principal pays créditeur du monde, les États Unis devinrent le principal débiteur. Malgré les avantages obtenus pour leurs exportations, les économies européennes et japonaises, menacées par le reflux des capitaux, durent à leur tour relever leurs taux d’intérêts. Les Européens se sont efforcés de répondre à la dictature du dollar en construisant une monnaie européenne, qui a signifié l’adoption des mêmes politiques économiques que celles des capitalismes anglo-saxons. À partir des années 80 les pays développés ont assisté pour ces raisons à une spectaculaire diminution de l’inflation.
De toute façon, Washington décidait en 1985 que le dollar était trop fort et menaçait la structure industrielle des States (c’était les années pendant lesquelles la presse était remplie d’articles sur le « déclin américain » et la « désindustrialisation » de certains secteurs, comme par ex. l’acier, et de branches entières, comme celle de l’activité minière), décidant une réduction graduelle des taux d’intérêts, effectuée à partir de l’« accord de Plaza » à New-York au sein du G-7[79]. Le dollar ne baissa toutefois pas de manière nette, et la tendance générale de la balance des paiements américaine ne changea pas. Toutefois la diminution graduelle des taux d’intérêts détermina l’explosion de Wall Street jusqu’au premier choc de 1987, lorsque la bourse américaine perdit en une journée 22,6 pour cent, plus que lors du fameux « vendredi noir » d’octobre 1929[80].
Au-delà des motifs typiquement techniques qui peuvent concourir à expliquer une situation paradoxale sous de nombreux aspects (comme le fait que la demande élevée de dollars due à la croissance de l’économie asiatique ait contribué à en maintenir le cours élevé, alors que l’on sait que les taux d’intérêts sont inversement proportionnels à la marche de la bourse) il est évident que l’énorme augmentation des transactions financières alors en cours devient inexplicable si on ne la rapproche pas de la spéculation, laquelle à son tour apparaît au sein de cette accumulation de capital dont nous avons parlé précédemment. Il est suffisant de comparer la croissance de la bourse américaine avec la marche de la croissance économique pour se rendre compte que nous sommes en présence d’une bulle spéculative de proportions énormes. De 1982 au niveau le plus élevé de 1987, Wall Street croît de 927 % contre 50 % pour le PIB[81]. Du 19 octobre 1999, lendemain de la crise, jusqu’à Février 2000, l’indice est passé de 1937 points à plus de 11 000, si bien que nombreux sont ceux à parier sur un écroulement désastreux imminent[82]. Si il est en fait vrai que sans création de richesses et de valeurs il ne peut y avoir de spéculation financière, et que celle-ci est d’autant plus paroxystique que les espérances de profit de la société dont les titres sont échangés sur le marché sont élevés, il est d’autant plus vrai que désormais le montant du capital fictif global (Tableau VI) a atteint un multiple énorme des transactions réelles de biens et de services. Déjà en 1993 les flux financiers mondiaux dépassaient ces dernières de 50 fois, avec des transactions journalières sur le marché des changes de l’ordre de 900 milliards de dollars. En 1991 le montant des crédits internationaux représentait 44 % du PIB des pays de l’OCDE contre 4 % dix années avant, et dans la même période la négociation sur le marché des titres était passée de 120 à 1400 milliards de dollars[83]. Aujourd’hui aux États-Unis la capitalisation de la bourse à atteint 150 % du PIB, trois fois plus que dix années avant. Dans le même temps le pourcentage des américains qui investissent en bourse est passé de 21 % en 1990 à 43 % en 2000, et leur portefeuille d’actions est passé de 8 % de leurs actifs en 1984 à 25 % en 2000[84]. Mais ce n’est pas fini : la consommation est maintenue élevée aussi grâce à un endettement sans précédents des familles américaines, désormais proche de 89 % de leur revenu[85]. Selon certaines estimations la dette mondiale totale (états, familles et entreprises) croît à un rythme trois fois plus rapide que le PIB mondial. « Un gigantesque volcan qui pourrait à tout moment entrer en éruption »[86].
Tableau VI – Flux financier « cross border » USA
(Source : Goldman Sachs)
[retour au texte]
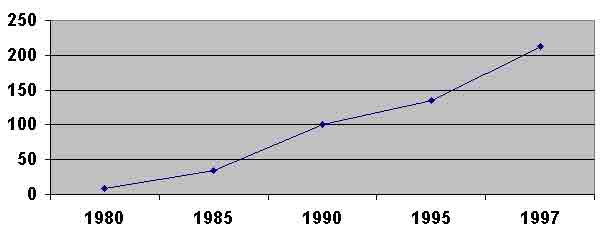
Entre les analystes il y a désormais une large convergence sur le fait que les marchés financiers off-shore, c’est-à-dire les paradis fiscaux comme les Iles Cayman ou les Bahamas, mais aussi HongKong et Singapour, manipulent des capitaux d’une importance telle qu’ils puissent rendre vain tout effort de contrôle, y compris concerté, entre les banques centrales. À leur tour les fonds d’investissements, en particulier les fameux « hedge funds » – qui selon certaines évaluations réalisent des actifs de l’ordre de 30 000 milliards de dollars, c’est-à-dire la production totale annuelle de la planète entière[87] – risquent, avec des opérations à découvert très dangereuses, de déterminer des flux financiers potentiellement déstabilisants lesquels, en cas d’insuccès, menacent d’entraîner tout le système financier mondial à la panique, comme lorsque la récente crise russe à mise à genoux l’hedge fund LTCM, sauvé précipitamment par la réserve fédérale et un consortium de banques américaines[88] à un pas d’une crise financière internationale de proportions gigantesques[89].
Il n’est donc pas surprenant qu’après le « big crash » de 1987 l’instabilité financière soit devenue une composante permanente de l’économie mondiale : en 1989 les bourses du monde entier vécurent d’autres journées de tension, en 1994 la crise de la dette mexicaine créa la panique sur les marchés financiers, obligeant le FMI et les États-Unis à intervenir en tant que payeur en dernier ressort. Enfin en 1997 une crise comparable, tant du point de vue des devises que de la bourse, par la quantité de capitaux détruits, à celle de 1929, a balayé l’Asie, annulant en quelques mois entre 60 et 90 % des valeurs des cotations[90], faisant trembler l’économie mondiale. En 1998 d’abord la crise du rouble puis celle des finances brésiliennes mirent les marchés en fermentation, vidant les caisses du FMI qui n’aurait pas eu la possibilité d’affronter une nouvelle épreuve. « Sans l’intervention des autorités monétaires – a écrit George Soros – le système financier international se serait écroulé en au moins quatre occasions : en 1982, en 1987, en 1994 et en 1997 »[91]. Et cependant, en novembre 1999, Clinton a éliminé définitivement toutes les limites que la crise de 1929 avait conseillé de poser au système financier. Le monde a-t'il oublié la leçon ?
Pour comprendre la gravité de la crise, on doit avoir présent à l’esprit qu’à son épicentre se trouvent le Japon et la Chine. Le premier, au moment où éclatait la bulle asiatique, traversait la plus longue période de dépression de son histoire, commencée en 1990 lorsque se terminèrent les fastes du marché immobilier nippon et que le Kabuchoto, la bourse de Tokyo (dont la capitalisation dépassait alors celle de New York) commença à descendre inexorablement, perdant 80 % de sa valeur en neuf ans[92]. En 1998 l’endettement total de l’économie japonaise arrivait selon certains analystes à quelque chose comme le double du PIB, menaçant sérieusement la solvabilité des grandes banques nippones, qui ne purent être sauvées que grâce à un maxi plan gouvernemental de l’ordre de 500 milliards de dollars. Et nous devons tenir compte du fait que le Japon, outre le fait de posséder la seconde économie mondiale, est le principal exportateur mondial de capitaux et le principal détenteur de bons du trésor américain. Il est facile d’imaginer quelles auraient pû être les conséquences si les banques japonaises, menacées de faillite, avaient commencé à retirer leurs capitaux du marché américain. En ce qui concerne la Chine, qui est désormais la septième économie mondiale, le pourcentage de crédits inexigibles détenus par ses banques s’approche probablement, comme au Japon, de 30 %, et c’est seulement l’inconvertibilité de sa monnaie qui lui a permis de ne pas dévaluer le yuan, ce qui a néanmoins fortement pesé sur ses exportations. Une dévaluation du yuan aurait eu des effets « dominos » ultérieurs sur les autres devises asiatiques qui auraient été contraintes à d’ultérieures dévaluations. La peur que les contrecoups que ces évènements auraient pu avoir ont poussé la Maison Blanche à promettre à la Chine l’entrée au WTO comme contrepartie de sa politique « responsable » en matière de change. « Le monde – a déclaré à ce propos le Ministre du trésor américain L. Summers – se trouve face à la crise la plus grave de ce dernier demi siècle »[93].
Le résultat le plus considérable de la crise de 1973–75 a cependant été d’avoir imposé à la production capitaliste un nouveau virage technico-scientifique et une révolution du mode de production immédiat. Ce qui au départ pouvait sembler être un processus de « désindustrialisation », qui vit couler à pic l’ensemble des secteurs miniers et industriels « lourds » (et en particulier le charbon et l’acier) prends toujours plus avec le temps l’aspect d’une restructuration générale de l’appareil productif, d’une « troisième révolution industrielle ». En réalité les productions « lourdes », comme précédemment celles à bas contenu technologique, ont été déplacées vers les pays de nouvelle industrialisation, lesquels avaient acquis entre temps les présupposés de la production moderne (instruction générale, transports, communications, constitution de l’armée industrielle, etc.). Dans les pays avancés, grâce à l’informatique et aux nouvelles technologies, grâce au passage de la mécanisation à l’automatisation, on privilégiait de manière de plus en plus marquée les productions dites « légères », à haute intensité de know-how, c’est à dire de capital constant-technologie, mais avec une moindre consommation de matières premières, d’énergie et de force-travail, ainsi que les activités telles que les projets, la comptabilité et l’administration, toujours plus informatisées[94]. Par exemple le poids dans la bourse américaine de Microsoft et d’Intel est désormais supérieur à celui de General Motors, la plus grande industrie mondiale, mais il est bien différent en ce qui concerne le nombre des employés (48 100 contre 721 000). Au total, les premiers vingt géants de l’informatique américaine emploient 128 420 travailleurs, à peine la moitié de celle du second constructeur automobile américain, Ford (325 300). La plus grande des nouvelles entreprises non informatiques, la Southwest Airlines, compte « à peine » 15 200 employés[95]. « La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner continuellement les instruments de production, les rapports de production, donc les rapports sociaux »[96].
Machines outil de haute technologie, robotique, microélectronique, software et ordinateurs, télécommunications, sciences des matériaux, biotechnologies, aviation et transports sont devenus alors les secteurs moteurs de l’économie capitaliste avancée[97], avec le développement de nouvelles zones industrielles non plus caractérisées par le gigantisme des installations, mais par un réseau de plus petites unités périphériques réparties sur le territoire (« entreprise diffuse »)[98], avec l’accroissement de la production de marchandises « immatérielles » comme les programmes informatiques, les télécommunications, les manipulations génétiques, produit du travail humain dont la valeur sur le marché dépend toujours plus du nombre d’heures de travail incluses dans la création que dans le coût de l’enveloppe matérielle, désormais accidentelle et subsidiaire.
De telles transformations, selon nos ennemis et ceux qui prétendaient avoir procédé au « dépassement du marxisme », mettaient définitivement le marxisme et son matérialisme brut en crise. Finalement le « travail intellectuel » avait sa digne reconnaissance dans la société, ou encore il ouvrait, envoyant en l’air la théorie de la valeur-travail, de nouvelles possibilités d’émancipation. En réalité les derniers développements du capitalisme ont remisé au grenier les interprétations vulgaires, mécaniques, grossièrement matérialistes. Et pourtant Marx l’avait dit : la valeur n’est pas une propriété physique des marchandises, mais le reflet d’un rapport social déterminé, l’échange des produits du travail humain au sein de l’anarchie mercantile. Le travail humain dans le cadre du marché créée des valeurs indépendamment de la forme de la valeur d’usage dans lequel il s’est concrétisé. Contrairement au « socialisme virtuel » en marche à travers le « réseau » dans lequel divaguent des théoriciens comme Toni Negri[99], le capital, incorporant les connaissances, les soumet aux besoins de valorisation tendant ainsi à la prolétarisation des intellectuels. Comme l’avaient anticipé Marx et Engels en 1847, la bourgeoisie « a transformé le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, l’homme de sciences, en salariés à ses ordres »[100].
Il est vrai que de nombreux « marxistes » ont rendu un fier service à la théorie en refusant obstinément d’admettre que la révolution technologique stimulée par la crise de 1973–75 avait modifié la structure de la base productive, rendant obsolète les instruments statistiques avec lesquels on avait jusqu’alors évalué son état de santé et son degré de développement. Ainsi si la production d’acier et les « cols bleus » des métallos ou le « museau noir » des mineurs devaient encore être considérés comme les paramètres d’identification du capitalisme avancé, l’URSS d’avant l’écroulement de 1989, lorsque sa production d’acier était la plus haute du monde, aurait été le pays bourgeois le plus moderne. De même, si seules les marchandises « pesantes » produisaient de la valeur et de la plus-value, la diminution déjà ancienne du prolétariat industriel sur le total des actifs dans les pays capitalistes mûrs aurait envoyé le capitalisme à terre en entraînant non seulement la baisse du taux, mais aussi de la masse des profits. Il est vrai en fait qu’à côté de nombreuses activités improductives ou même parasitaires rendues possibles par la hauteur du taux de plus-value de la société moderne (commerce, intermédiaires, banques, assurances, finances, travail domestique, etc.) la catégorie statistique des « services » – qui aux USA emploie désormais 75 % de la population active, et en Italie 64 %[101] – comprend de nombreuses activités (en particulier liés à la production de processus cognitifs et technologiques, au tourisme, au transport, aux communications, etc.) productives au sens capitaliste puisque, comme l’explique Marx, ce qui est productif est, indépendamment de sa forme, le travail qui créée de la valeur et de la plus-value[102]. Par ailleurs, sous la rubrique « services », la statistique bourgeoise comptabilise des activités qui étaient jusqu’à hier considérées comme pleinement industrielles. On lit dans le passage suivant :
« L’expansion du secteur des services est généralement attribué en premier lieu à la restructuration du secteur industriel intervenue après la crise pétrolière de 1973–74. Par suite de la réorganisation du processus de production alors intervenu, les industries manufacturières ont eu recours toujours plus massivement à l’out-sourcing [sous-traitance], c’est-à-dire au transfert de leurs activités non-essentielles à des fournisseurs de services externes. En conséquence le secteur des services a assumé un rôle considérable dans la compétitivité globale de l’industrie manufacturière. En effet, la capacité d’un produit à être concurrentiel dépend d’une vaste gamme de services : déjà avant le début du process de production entrent en jeu des services sous la forme d’études de faisabilité, d’études de marchés, de design du produit, etc. Des services tels que le contrôle qualité, le leasing d’équipements, l’entretien et les réparations constituent des parties intégrantes du process de production. Dans la phase finale les services jouent un rôle fondamental non seulement dans le secteur de la publicité, des transports et de la distribution, mais aussi dans ceux de l’assistance aux clients (par exemple l’entretien et la formation de l’utilisateur). Enfin les services en matière de software, d’expertise en gestion, de formation, de télécommunication, d’assurance et d’intermédiation financière sont toutes fondamentales) pour le bon fonctionnement d’une entreprise »[103].
Avec tout ceci – les rendant pathétiques dans leurs efforts de démontrer la « crise irréversible » du capitalisme – il y en a encore qui s’obstinent à ne prendre en considération que la production industrielle comme source d’extraction de plus-value.
L’informatisation du processus de production et de distribution des marchandises a rendu par ailleurs possible la réduction de certains coûts fixes (par exemple ceux dus à l’approvisionnement et au magasinage) ainsi que la production dite just in time, avec d’inégalables effets positifs sur le taux de profit induis par les moindres débours de capital anticipé. Sur le lieu de travail ce processus a été accompagné par la progressive limitation de la production « fordiste » des « chaînes de montage » au sein de grandes structures industrielles, et de l’extension à toujours plus de secteurs du « toyotisme », c’est à dire de la production par des équipes de travailleurs polyvalents co-intéressés à l’obtention d’objectifs déterminés et de standards de qualité (« qualité totale »), avec comme résultat une plus grande saturation du temps de travail par employé[104]. Les nouveaux rythmes de travail impliqués par la production en « îlots » d’un côté, la volonté d’accélérer la rotation du capital de l’autre, suggéraient ensuite une restructuration des horaires de travail qui permette le fonctionnement des installations vingt quatre heures par jour et lorsque c’était possible sept jours par semaine. Ainsi dans un nombre toujours plus grand de branches industrielles se sont introduits les quatre vacations de six heures et par la suite des solutions encore plus pointues d’horaires variables selon les exigences et les cycles du marché (« horaires flexibles »), comme chez Wolkswagen ou dans le textile italien. Ces méthodes purent désormais d’autre part être introduites dans des secteurs toujours plus étendus des services (par exemple dans les supermarchés)[105]. Ici est le secret de la contemporanéité et de formes de réduction de l’horaire de travail et d’un allongement total des heures effectivement travaillées dans certains pays et secteurs, comme les États-Unis, ou elles sont passées de 1883 en 1980 à 1996 en 1997[106]. « La continuelle révolutionnarisation de la production, le bousculement ininterrompu de toutes les situations sociales, l’incertitude et le mouvement incéssant distinguent l’époque des bourgeois de toutes les époques précédentes »[107].
E – L’aggravation des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière
[prev.] [content] [next]
Au total la « production flexible » ainsi articulée a permis une indubitable récupération du taux de profit des entreprises, maintenant structurellement élevé (comme nous l’avons déjà dit) l’armée industrielle de réserve et contribuant à tenir les salaires bas (Tableau VII), c’est-à-dire à augmenter aussi de cette manière la plus-value extorquée aux travailleurs[108]. Celle-ci a été accompagnée en outre d’une restructuration, ou mieux d’une deregulation totale du marché du travail, avec la réduction progressive de l’aire du travail « garantis », ou, pour le dire à la japonaise, du « travail à vie », et la croissance de contrats temporaires, précaires, « flexibles », et de nouvelles figures prolétariennes comme celles des travailleurs « intérimaires », des contrats de formation, etc. En Allemagne et en Italie ils constituent désormais un tiers du total[109], mais parmi les nouveaux embauchés ce pourcentage est désormais supérieur à 50 %.
Tableau VII – Croissance de la production mondiale (en %)
(Source : Livre des faits 2000)
[retour au texte]
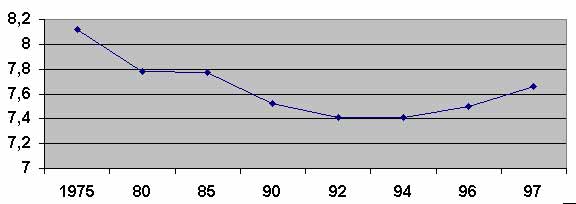
Cette dérégulation du marché du travail a son correspondant dans la politique salariale des entreprises et dans l’évolution des négociations collectives : dans tous les pays capitalistes avancés on a assisté à la croissance de la part « flexible » du salaire, c’est-à-dire à la réduction de la part du salaire négociée centralement, et à la croissance à la place de sa partie liée à la production, aux contrats d’entreprise, à la reconnaissance individuelle. Dans le même temps les sphères des négociations nationales sont aussi diminuées.
Au niveau social, la crise du « fordisme » entraîne la réduction de l’enchevêtrement de services sociaux qui, comme on l’a vu, étaient rendus nécessaires par l’absence de fluidité de ce système, essentiellement rigide, ce qui a permis la démission du welfare state réclamé à grandes voix par les prophètes de la « privatisation »[110].
Le processus de transformation de la classe travailleuse « fordiste » en « post-fordiste » est donc la base objective de la crise du mouvement ouvrier occidental et de la disparition de la tradition trade-unioniste que celui-ci, bien qu’ayant perdu ses traditions classistes à partir du premier après-guerre, avait maintenu sur les lieux de travail comme fruit des luttes passées et dans quelques pays (comme en Italie et en France) renforcé dans les années 60 et 70. L’une après l’autre les grandes organisations syndicales d’entreprises ou de catégories typiques de la production fordiste se sont transformées en institutions bureaucratiques adonnées à la défense du « citoyen travailleur » et encore plus étroitement intégrées à l’État bourgeois, diminuant d’effectifs sur les lieux de travail jusqu’à entrer dans un état comateux[111]. Aux États-Unis, par exemple, déjà à la moitié des années 90 « les inscriptions aux syndicats sont passées à 11–12 % du total de la force de travail salariée, alors que dans les années 50 ils étaient environ un tiers de la force de travail »[112]. Les habituelles trahisons des bureaucrates sont donc seulement un des aspects des affaissements successifs des organismes syndicaux traditionnels : rentre également en jeu l’évidente inadéquation historique de cette forme à gérer, même d’un point de vue purement collaborationniste avec le pouvoir bourgeois, la transformation de la clase ouvrière en cours[113].
Si les conditions de vie du prolétariat ont empiré, si le nombre des chômeurs et des temps partiels a augmenté, ce que Luttwak appelle le « turbocapitalisme » pousse à une augmentation de la pauvreté, non seulement dans le tiers-monde, mais aussi dans l’Occident avancé. Considérons les États-Unis dont les performances économiques ont pris dans les années 90 dans les journaux la place occupée par le Japon dans les années 70 et 80 : le miracle « américain » révèle une divergence croissante entre le nombre restreint des riches et « nouveaux riches » et une augmentation croissante du nombre des pauvres et « nouveaux pauvres ». Si en 1977 les 5 % des familles américaines les plus riches s’appropriaient 16,8 % du revenu total, en 1994 ils jouissaient de 21 % de celui-ci. Au contraire les 20 % les plus pauvres des noyaux familiaux ont vu dans le même temps passer leur part de 4,1 % à 3,6 %. Même les 20 % immédiatement suivant des revenus familiaux sont tombés de 10,2 % à 8,9 % du total. Actuellement, une fois rajoutés les interventions de l’assistance publique, les 40 % des familles les plus pauvres détiennent 16,2 % du revenu total contre 44,1 % aux 20 % les plus riches[114]. Pour maintenir leur niveau de vie constant, les Américains doivent en moyenne travailler 245 heures en plus par an, avec de lourds effets sur la vie familiale et scolaire[115].
« … on peut comprendre que les fameuses pathologies du sous-prolétariat ne sont pas si pathologiques que ca. Indubitablement le statut de chômeur chronique est moins douloureux pour qui n’est pas sobre, pour qui se tient loin de la drogue, et ne brûle pas du désir de travailler. […] La crise de la famille peut être expliquée aussi sur la base de facteurs culturels, mais elle est certainement déjà inscrite dans la carence de postes de travail pour ceux qui n’ont aucune formation. Dans cette période la criminalité se révèle un fait fonctionnel : non pas une sorte de déviance mais un choix rationnel »[116].
Parallèlement, la société américaine a vu croître la délinquance à des niveaux jamais connus précédemment. De 1975 à 1995 sa population carcérale a cru de six fois. En 1998 celle-ci englobait désormais 1 800 000 personnes, soit 6,6 pour mille de la population[117].
Malgré l’orgasme financier durable décrit précédemment et un état du marché dans lequel chaque jour est vécu comme le dernier et dans lequel les capitaux à court terme dominent toujours plus les humeurs, la reprise économique mondiale (surtout américaine) dans les années 80 et (après une contraction au début de la décennie) dans les années 90 n’a jamais été égalée (Tableau VIII).
Tableau VIII – Croissance de la production mondiale (en %)
(Source : Livre des faits 2000)
[retour au texte]
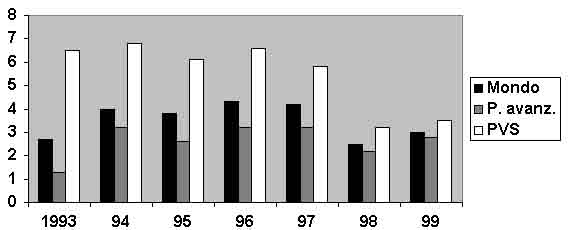
En février 2000, les USA entrèrent dans le 107e mois d’expansion sans interruption, le plus long de toute leur histoire[118]. Avant la récente crise c’était l’aire asiatique qui avait le rythme de développement le plus élevé, avec des conséquences géopolitiques de premier ordre puisque l’aire du Pacifique a désormais dépassé celle de l’Atlantique comme centre stratégique de l’économie-monde et que c’est en Asie que se concentrent désormais la majeure partie de l’économie mondiale(Tableau IX), si bien que certaines études pronostiquent qu’il s’agit de l’aire qui se substituera à l’aire américaine dans le guidage du capitalisme mondial lorsque le « cycle américain » d’accumulation s’épuisera comme c’est advenu dans le cas de l’Angleterre et, avant encore, de la Hollande[119].
Dans tous les cas la classe ouvrière de cette région, après les grandes luttes des ouvriers chinois du début du siècle, ont fait leur entrée dans l’histoire de la lutte de classe, en particulier en Corée du Sud en 1987, 1990 et 1998.
Tableau IX – Croissance de la production. Comparaison USA – UE – Économies asiatiquse avancées.
(Source : Livre des faits 2000)
[retour au texte]

Il est évident que cette nouvelle expansion du capitalisme mondial est liée aux transformations qui se sont produites dans l’appareil productif et que nous avons décrites ci-dessus. Une fois pour toutes, donc, disparaît l’idée qu’il existe un point à partir duquel l’économie du capital entre dans une crise absolue et irréversible, à laquelle malheureusement certaines personnes qui comprennent mal Marx continuent de donner crédit, offrant aux adversaires du matérialisme historique la possibilité d’une réfutation facile. Et même ici, nous ne pouvons que répéter comment le texte marxien ne laisse aucune place au doute.
« Il n’y a pas de crises permanentes ».
Marx avait écrit[120], expliquant :
« [Les crises] sont toujours des solutions seulement temporaires et violentes aux contradictions existantes, violentes éruptions qui rétablissent momentanément l’équilibre perturbé […]. La dépréciation périodique du capital existant, qui est un moyen immanent du mode capitaliste de production pour arrêter la diminution du taux de profit et accélérer l’accumulation de valeur-capital moyennant la formation de nouveaux capitaux, perturbe les conditions données dans lesquelles s’accomplit le processus de circulation et de reproduction du capital, et provoque en conséquence des arrêts improvisés et des crises du processus de production […]. Mais dans tous les cas, pour rétablir l’équilibre, il était nécessaire de laisser inactif, ou même de détruire, une quantité plus ou moins grande de capital […]. Il s’effectuerait, à cause de l’interruption du système productif, une destruction encore plus forte et effective de moyens de production […]. La principale destruction, au caractère le plus grave, interviendrait pour le capital en ce que celle-ci posséderait le caractère de valeur, et donc pour les valeurs-capital […]. Une part des marchandises à disposition sur le marché ne peut accomplir son processus de circulation et de reproduction que moyennant une énorme contraction de son prix de son prix, c’est-à-dire moyennant une dépréciation du capital que celles-ci représentent. De même tous les éléments du capital fixe deviennent plus ou moins dépréciés […]. La rétraction de la production a comme conséquence le chômage d’une partie de la classe ouvrière et l’acceptation par celle qui est au travail de réductions de salaire même au dessous du salaire moyen : opération qui a pour le capital l’effet identique à celui d’une augmentation de la plus-value absolue ou relative, avec un salaire resté inchangé […]. En outre, la dépréciation des éléments du capital constant constitue en soi un facteur qui provoque une augmentation du taux de profit. La masse de capital constant employé par rapport au capital variable est accrue, mais la valeur de cette masse peut être diminuée. Le ralentissement de la production a préparé – dans les limites du capitalisme – une augmentation ultérieure de la production. Et ainsi la circulation tend à se reproduire. Une partie du capital, dont la valeur a diminué suite à l’arrêt de sa fonction, regagne sa valeur précédente. Et a partir de ce même moment le cercle vicieux se répète avec des moyens de production plus considérables, avec un marché plus étendu et avec une force productive plus élevée »[121].
Les dernières vingt années d’histoire du capitalisme ont donc mis en déroute aussi la thèse, sortie de l’expérience de deux guerres mondiales rapprochées et entrecoupées par une grave dépression, de ce que la guerre générale serait l’unique moyen consenti au capital dans la période impérialiste pour surpasser ses crises de surproduction, ou encore aurait une nécessité strictement économique. Sans pour autant nier que les guerres soient un socle périodique inévitable des contradictions économiques et politiques de l’impérialisme, sans nier autrement l’effet que celles-ci assument, grâce aux massives destructions de capital, dans la périodique régénérescence du monstre capitaliste, l’expérience a montré que même sans guerre le capitalisme peut venir à bout de ses crises, même si c’est de manière moins durable.
Il suffit de réfléchir sur les immenses effets dévastateurs que la crise a assumé dans les pays de l’Est européen pour comprendre que le capital sait réellement être, même sans guerres, le système le plus dilapidateur de forces productives sociales qui aie jamais existé (Tableau X – Tableau XI).
Tableau X – Variation du PIB russe
(Source : Guarracino)
[retour au texte]
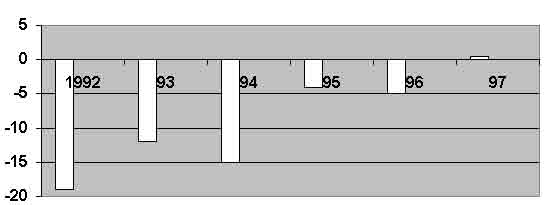
En effet ce qui est advenu dans les économies et la société de l’ex-bloc Soviétique et dans les Balkans, avec son cortège de guerres et de destructions, est un indice ultérieur important des contradictions de la reprise capitaliste de ces vingt dernières années. Du fait que la crise des années 70 a comporté une modification du mode de production, mais aussi des aires de développement du capitalisme. Même si la « grande confession » d’être en tout et pour tout capitaliste que les communistes internationalistes avaient pronostiqués dans les années 50 pour les pays du « socialisme réel » ne s’est pas réalisée, l’écroulement du système soit-disant soviétique est une victoire théorique en ce qu’ils avaient compris le caractère non-socialiste de cette structure économico-sociale et l’impossibilité pour celle-ci de rejoindre le niveau de l’Occident.
Tableau XI – Variation du PIB 1991 – 1997 Europe de l’Est.
(Source : Rivista del Manifesto, Décembre 1999)
[retour au texte]
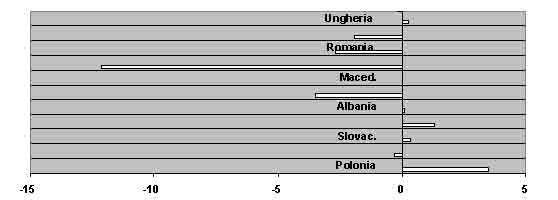
C’est seulement à partir du dévoilement du caractère bourgeois de ces systèmes qu’il est possible de comprendre les évènements qui les regardent : l’année 89 de ce siècle ne représente pas leur passage du « socialisme » au communisme, mais la crise d’une aire arriérée face à la force de l’aire développée et aux mouvements capricieux par lesquels le marché mondial déplace les capitaux à la recherche de profits. Ce qui est advenu dans l’Est européen n’est pas très différent que ce qui est arrivé dans les aires les plus faibles du capitalisme mondial, à leur tour pris au piège d’un endettement croissant (Tableau XII). L’analogie de situation est tout autre que conjoncturelle : elle est -mutatis mutandis – l’indice d’une homologie sociale. D’autre part ce sont les mêmes nomenklaturas drapées hier du manteau socialiste qui se déclarent aujourd’hui les champions convaincus du « libéralisme » économique le plus effréné. Et ceci est, à sa manière, une confession. Non seulement du « faux socialisme » mais aussi de la nature permanente du capital : avec 1989 reviennent officiellement en Europe la misère, les nationalismes, les guerres. Même si elle n’a pas directement préparé la troisième guerre mondiale, la crise de 73–75 en a posé quelques prémisses pour le futur.
Tableau XII – Dette extérieur en milliards de dollars
(Source : État du monde 1998)
[retour au texte]
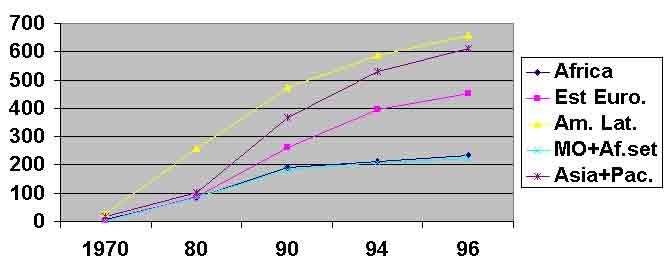
Comme le savaient bien les communistes révolutionnaires qui au milieu de ce siècle en scrutaient le futur, « les crises grandes et petites ont le même caractère qualificatif : l’indice de la production industrielle générale décroît pour un certain nombre d’années jusqu’à ce qu’il recommence à monter »[122].
« Par quel moyen – se demande le « Manifeste du parti communiste » – la bourgeoisie dépasse t'elle ses crises ? D’un côté par la destruction forcée d’une masse de forces productives; de l’autre par la conquête de nouveaux marchés et l’exploitation plus intense des vieux. Donc, par quels moyens ? Par la préparation de crises plus générales et plus violentes et la diminution des moyens de prévenir ces mêmes crises »[123].
Poussé par la crise des années 70, le capitalisme est en somme entré dans une nouvelle phase, paraphrasant Marx dans un nouveau « cercle vicieux », un « nouveau grand investissement », basé sur un « nouveau fondement matériel » de son « cycle de rotation ». Caractéristiques de cette nouvelle phase sont :
une base productive élargie aux pays entrés entre-temps au sein de la production capitaliste, principalement dans la région d’Asie-Pacifique, mais pas seulement (penser à l’Afrique du Sud, au Brésil, etc.);
une localisation différente du capital mondial, avec la perte d’importance de certaines aires (par ex. celle de l’ex « empire soviétique ») et la croissance d’autres (par ex. les « tigres asiatiques »);
le passage – grâce à l’introduction de nouvelles technologies, l’informatique in primis – du mode de production fordiste à celui de la « lean production » (d’origine japonaise mais qui dans sa structure actuelle va bien au delà), avec les conséquences en dépendant sur le processus de production, le marché du travail, le chômage, les salaires, le régime des horaires de travail, les « garanties » sociales et la classe ouvrière elle-même; conséquences que l’on peut résumer d’un côté par le concept de « flexibilité » et de l’autre dans une contre-tendance générale à la chute du taux de profit;
une financiarisation de l’économie plus poussée, avec ses conséquences d’instabilités croissantes et permanentes des marchés.
Il convient de relever aussi que, malgré l’imposante dimension de la reprise réalisée dans certaines aires au sein de cette nouvelle phase, et en dépit de ce que le taux mondial de croissance enregistre indubitablement un solde positif, la reprise capitaliste a été particulièrement difficile et contradictoire, confirmant à nouveau la tendance à la « chronicisation » de la crise qu’Engels avait déjà noté aux temps de la « grande dépression » et que les années suivant la crise de 1929 avaient confirmé. Mais crise « chronique » ne signifie pas crise « permanente » ou « irréversible », concepts qui s’opposent à la description classique du capital donnée depuis le « Manifeste ». Ceci signifie que, au sein de l’économie capitaliste avancée, et en particulier dans sa phase impérialiste, l’influence des trusts et des monopoles, l’intervention de l’État dans l’économie, l’influence gigantesque du crédit et du levier monétaire, la force des grandes puissances impérialistes, agissent sur le cycle économique en en perturbant les rythmes. D’un côté ceci tend à reporter dans le temps l’explosion violente de la crise et tend à l’atténuer; de l’autre ceci finit de temps en temps par donner à la crise un caractère plus profond, c’est à dire plus catastrophique et violent, ou plus prolongé, ou le tout ensemble.
« […] les grandes crises de production, pour les plus puissants capitalismes les plus bouleversés par les guerres […] sont du même ordre de grandeur que les arrêts de production à la suite de conflits guerriers et d’invasions dévastatrices. La doctrine des crises est déjà dans Marx et celui-ci avait vu en elles une période décennale […]. Mais ces crises du jeune capitalisme sont d’importance plutôt mineures et ont plus le caractère de crises du commerce international que de la machine industrielle. Celles-ci n’entament pas le potentiel de la structure industrielle […]. C’était des crises de « chômage », c’est à dire de fermeture, de lock-out des industries. Les crises modernes sont des crises de désagrégation de tout le système, qui doit ensuite reconstruire péniblement son ossature avariée »[124].
Jamais comme depuis la dernière crise, en effet, le chemin du cycle de production pour le profit n’a été pavée de contradictions si gigantesques et croissantes : dans ce dernier quart de siècle il n’y a pas eu un moment ou le capitalisme ait donné l’idée d’avoir réalisé un cycle comparable à celui du second après-guerre : la désagrégation prolongée de l’Est européen, la longue dépression japonaise, le récent écroulement asiatique, les crises monétaires et financières répétées et dévastatrices ont signé le lugubre retour du spectre de la crise de 1929, opposant d’un côté les pays pauvres au Fonds Monétaire International et à la Banque Mondiale, qui donnèrent à ces premiers une politique économique fonctionnant à l’occidentale et les conditions d’accès au crédit, et d’un autre côté opposèrent entre elles les principales devises internationales, dollar, yen, mark et à présent euro. L’année 1999 s’est close, symboliquement, par l’échec du WTO, successeur du GATT, menaçant d’engager le marché international le long d’une nouvelle pente protectionniste.
À leur tour, les tensions internationales se sont constamment aggravées. D’une part l’impérialisme a été appelé à taper sans pitié, mais par toujours avec succès, sur les ambitions d’acquérir une réelle autonomie et un profil moderne de la part des pays émergents : c’est advenu en Iran, lors de la guerre des Falkland en 1983, contre l’Irak en 1990–91; d’autre part il a cherché à remplir et exploiter les vides stratégiques laissés ouverts par les situations de désagrégation géopolitique comme au Liban (1982), en Somalie (1992), dans les Balkans, au Caucase; d’un autre encore il est intervenu dans la coulisse (mais pas seulement) comme en l’Afghanistan et dans ceux qui ensanglantent l’Afrique. Un nombre toujours plus élevé de pays s’est coalisé lors de guerres toujours plus longues, coûteuses, dévastatrices et sans voie de sortie. Les contrastes entre puissances dans la péninsule balkanique, l’élargissement de l’OTAN à la Pologne, la République Tchèque et la Hongrie, les prétentions chinoises sur Taiwan, les contrastes toujours plus ouverts entre Japon et USA d’un côté, entre UE et États Unis de l’autre, l’abandon précipité d’Eltsine du dernier G8 à cause de ses désaccords avec les grands sur la Tchétchénie témoignent du fait que la perspective d’une guerre mondiale, comme prévu par Engels à la fin du XIXe siècle, n’est pas étrangère au siècle qui s’ouvre.
Du point de vue géopolitique la récente guerre des Balkans a enregistré, outre le remaniement de la Serbie et la partition de l’aire entre impérialismes, la prédominance de la puissance globale américaine sur les intérêts des « alliés » européens et l’encerclement de la Russie, menacée par l’extension de l’OTAN à la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque.
Au-delà d’un unitarisme de façade, Européens et Américains ont affronté le conflit avec des intérêts différents, des stratégies différentes, avec l’idée de se soustraire les uns des autres les sphères d’influence. Les Américains ont exploité leur contrôle des commandes de l’Alliance atlantique pour diriger les bombardements non seulement contre l’armée serbe et les objectifs civils, mais aussi contre la structure industrielle de la Serbie dont, il faut le rappeler, une grande partie est le fruit de la collaboration entre européens et Belgrade, quand même elle n’appartient pas au capital européen, italien et allemand en première ligne. En bombardant les industries propriétés de joint-ventures germano-serbe et serbo-italienne (par ex. la Telekom serbe), l’OTAN a travaillé pour le capital américain contre le capital européen, en particulier allemand (dont un des projets majeurs de développement se situe sur l’Axe Danubien) et italien. La présence américaine en Macédoine et en Albanie, outre le fait de contester l’aire d’influence de Rome vise à contrôler le fameux « corridor 8 » qui – suivant un projet de l’ENI – devait transporter le pétrole du Caucase vers l’Adriatique. De cette manière Washington entend mettre à genoux les exportations russes d’« or noir » et tenir sous son contrôle la volonté européenne de s’émanciper des fournitures – contrôlées par les yankees et les anglais – provenant du Moyen-Orient. Comme l’a écrit Stefano Cingolani sur le « Corriere della Sera » du 26 avril 1999, « …tant de songes européens disparaissent dans l’aube rose des Balkans ».
L’intervention américaine répond, comme l’écrivent les deux politologues américains Heilbrunn et Lind, « à une nouvelle stratégie impériale, qui pose ses frontières en Europe du sud-est » et vise à porter l’hypothèque américaine dans le « ventre mou » de l’Europe. C’est clair : l’élargissement à la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie de l’OTAN n’a pas été tournée seulement contre la Russie.
C’est pour ceci que les Européens, Italiens et Allemands en premier, ont désespérément cherché, en y associant la Russie, une solution politique qui d’une certaine manière bride la prédominance des USA. C’est pour ceci que la papauté, mettant de côté sa politique séculaire d’affrontement avec l’église orthodoxe pour la pénétration à l’Est, a pris position pour la fin des hostilités. C’est aussi pour ceci que le fantoche pacifiste Rugova s’est envolé pour Rome avant de poursuivre pour Berlin et le Vatican.
En somme cette guerre, qui derrière l’apparente compacité de l’OTAN met à nu comme jamais les différences d’intérêts entre les puissances, a été la prémisse d’une future guerre mondiale. Comme on peut le lire dans un volume qui rassemble les voix les plus disparates de la « gauche » à la « droite » européenne (Alain de Benoist, Giulio Andreotti, Luciano Canfora, Maurice Couve de Murville, Massimo Fini, Giorgio Galli, Harold Pinter, Alexandre Zinoviev, etc.), le conflit des Balkans a vu « l’émergence, encore magmatique, d’une conscience bourgeoise de l’existence d’intérêts contradictoires entre les deux rives de l’Atlantique »[125]. Fait encore bien plus significatif, le conflit a vu émerger la disponibilité d’une série de forces de « gauche » à un alignement anti-impérialiste générique qui pourrait dans l’avenir se montrer fonctionnel dans la défense des intérêts de la partie du capital européen qui se cabre le plus contre le joug américain[126].
L’opposition à la guerre a donc vu objectivement converger une série de forces hétérogènes : en Italie, outre les forces bourgeoises dont nous avons parlé, catholiques, partisans de la Ligue du nord, Refondation communiste, centres sociaux, syndicats de base, éléments de la soit-disant « gauche révolutionnaire » et enfin nationalistes serbes. Le plus petit dénominateur commun entre ces forces à consisté à proclamer « illégale » l’« agression » de l’OTAN contre un pays « souverain », la Serbie, reconnue par le « droit international »[127].
La poussée d’anti-américanisme renouvelée a trouvé, dans ses versions extrêmes et ouvriéristes, une justification à son propre alignement pro-serbe par la permanence de traces présumées « socialistes » dans l’économie et la société yougoslave.
En substance, de la même manière qu’au temps de la « Résistance antifasciste » ils s’étaient placés sous l’aile protectrice des impérialismes américains, anglais et russe, contre le « nazifascisme », aujourd’hui les « gauches » se sont placés sur le terrain de l’alignement bourgeois, celui russo-serbe, contre l’autre, celui de l’OTAN. De cette manière ils ont posé leur propre candidature à l’appui de la politique nationale et européenne en vue du moment ou les contradictions entre les intérêts européens et américains émergeront à la lumière, lorsque les bourgeoisies italienne et européenne en auront assez de voir leurs propres usines bombardées par les avions de l’OTAN, croyant avoir la force de s’opposer à la super-puissance américaine.
La contre-épreuve peut être observée aujourd’hui par le cours de la guerre en Tchétchénie. C’est la riposte russe aux menées occidentales. Les Russes sont bien conscients de la volonté de Washington de favoriser la désagrégation de la Fédération de Russie pour mieux contrôler le fameux « corridor » qui des pays de l’Est, et en particulier du Caucase, devrait transporter les marchandises, le pétrole et le gaz vers l’Europe. Ils voient donc dans l’indépendance de la Tchétchénie le danger d’une perte de contrôle sur toute la région. En somme, la guerre en Tchétchénie, qui se déroule alors que nous écrivons, est la continuation de la guerre des Balkans, un autre épisode de l’affrontement toujours plus ouvert entre impérialismes. Ce n’est donc pas un hasard si aucune des forces d’« opposition » à la guerre des Balkans (ou mieux, aux guerres des Balkans), qu’elles soient de « droite » ou de « gauche », n’a dit un mot, émis une protestation, réclamé la mobilisation contre l’intervention russe.
Nous n’hésitons pas à dire que l’élaboration de cet alignement fluide et transversal anti-américain est le fait politique le plus dangereux de ces dernières années : de la même manière que la guerre civile espagnole fut la preuve de la constitution des alliances de la seconde guerre mondiale (pas seulement du point de vue militaire mais aussi politique) par l’élaboration du mot d’ordre international de la lutte contre le nazi-fascisme comme arme idéologique de la participation du prolétariat au conflit, la guerre des Balkans a jeté un pont entre la soit-disant « extrême gauche » et le capital pro-européen pour une éventuelle future mobilisation anti-américaine.
La guerre dans l’ex-Yougoslavie est en somme l’épisode initial d’un nouveau cycle au cours duquel les diverses forces politiques, plus rapidement que par le passé, évolueront vers leur destin historique. Qui aurait cru, il y a quelques mois, que les gouvernements de « gauche » se seraient jetés dans une telle guerre ? De la même manière les forces qui aujourd’hui dissimulent leur nature en masquant leurs propres options philo-serbes, philo-européennes et anti-américaines évolueront rapidement.
Si nous revenons aux analyses élaborées par les marxistes à partir de la fin du siècle dernier, nous voyons se confirmer, en substance, l’idée que les contradictions du capitalisme se sont développées en grossissant et en se multipliant. Que sans la victoire révolutionnaire des guerres et des crises toujours plus destructrices auraient impliqué l’humanité. Que le capital financier aurait toujours plus globalement dominé l’économie du capital. Aujourd’hui, bien que la concentration du capital soit arrivée au point où deux cent méga-sociétés contrôlent 26 % du PIB mondial, autant que 150 pays non-membres de l’OCDE[128], les grandes sociétés par action et les « public company » qui impliquent un grand nombre de petits actionnaires démontrent de manière toujours plus forte la tendance à faire de la classe bourgeoise un « réseau d’intérêts » toujours plus impersonnel qui englobe la planète plutôt qu’une couche identifiable de gras capitaines d’industrie au cigare à la bouche.
En ce qui concerne les conditions de vie et de travail immédiates du prolétariat, à la lumière de tout ce siècle qui finit, les « trente glorieuses » – avec leurs « garanties sociales » particulières – se montrent une phase particulière, liée au « fordisme », du développement du système bourgeois, et non une architecture permanente de celui-ci. Nous avons d’abord vu, entre dépression et guerres en chaîne, en nous voyons aujourd’hui, entrant dans le règne de la deregulation et de la « flexibilité », s’accroître, outre la misère relative, l’insécurité et la précarité de l’existence. Quel futur, dans le monde globalisé, pour les millions d’hommes et de femmes du Tiers-monde étranglé par les usuriers du Fonds Monétaire International, sinon la misère ou l’émigration sauvage ? Quel futur dans les pays de l’Est européen gangrenés par la délinquance mafieuse, l’arrogance des parvenus, la prostitution ? Quel futur pour les jeunes occidentaux menacés par un chômage qui arrive dans certains pays européens à 30 % ou encore, comme en Italie, les dépasse ?[129]
« Les études démontrent – observe Silvia Vegetti Finzi, doyen de psychologie dynamique à l’Université de Pavie – que les adolescents ont une vision du futur qui contient beaucoup moins de projections que celle des générations précédentes. Ils se sentent dégagés de toute responsabilité, disent que la société veut peu de leur part (ou trop ? NdR) et vivent dans un grand ennui ».[130]
Sur les lieux de travail les rythmes croissants de travail et la menace de perdre son emploi ne concernent plu seulement l’ouvrier non-spécialisé. De la même manière que l’ouvrier spécialisé menacé par l’automatisation des processus productifs, l’employé et le technicien, substitués dans leurs fonctions en nombre toujours croissant par les ordinateurs, voient se dissoudre leurs privilèges, s’abaisser leurs salaires et diminuer la sécurité du poste de travail. Ce processus concerne aussi naturellement les services, et parmi eux les services d’état, ou l’électronique et l’informatique ont rendus superflus nombre des compétences des fonctionnaires. Même les tâches qui consentaient encore à certaines catégories d’employés une marge d’autonomie et de créativité (dessinateurs, architectes, etc.) sont assujettis au travail de la machine, même si cette machine s’appelle Personal Computer.
« Encore en 1975 – écrit Pietro Inchino, professeur de droit du travail à Milan – on pouvait penser former un soudeur avec l’idée qu’il aurait travaillé pendant 25–30 ans sur le même type de machine. Alors qu’aujourd’hui le rythme d’obsolescence technique varie de 1–2 ans à 2–5 ans et concerne non seulement la machine mais aussi le produit. On forme aujourd’hui pour une période plus brève et on doit être disponible pour une nouvelle qualification après 5–10 ans, pour faire la même chose ou une chose totalement différente ».[131]
Tri optique du courrier, substitution à celui-ci d’un tri électronique, lecture optique des prix au supermarché avec communication électronique en temps réel des ventes, substitution des agences bancaires par des guichets automatiques, télétravail, ordinateurs à reconnaissance vocale, logiciels exécutant le travail de médecins, architectes, ingénieurs, traducteurs, images holographiques d’enseignants projetées en classes, vidéoconférences. Ce ne sont pas des choses de demain mais d’aujourd’hui. De ce point de vue, le nouveau millénaire était hier. L’hypothèse que le progrès technique tend irrésistiblement à élargir la prolétarisation et l’armée industrielle de réserve n’est donc plus une calomnie des marxistes mais l’objet d’une terreur bien fondée des bourgeois.[132]
« Avec l’extension de l’utilisation des machines et de la division du travail – lit-on dans le « vieux » « Manifeste » du « vieux » Marx – le travail des prolétaires a perdu tout caractère indépendant et en conséquence toute attractivité pour l’ouvrier. (…) Les intérêts, les conditions d’existence propres du prolétariat s’égalisent au fur et à mesure que les machines annulent les différences de travail et font descendre pour presque tous le salaire à un niveau également bas ».[133]
Au total, l’ultime quart de siècle montre un visage du capitalisme qui, bien plus que celui du second après-guerre, correspond au modèle capitaliste tracé par Marx dans ses analyses sociales, historiques et économiques. Le « Manifeste du Parti Communiste » – même un hâbleur pseudo-marxiste comme Hobsbawm a dû le reconnaître[134] – n’habite pas le capitalisme du temps de Marx, comme les gens superficiels l’ont toujours présomptueusement prétendu, mais maintenant, à l’ère de la soit-disant « globalisation », qui est tout autre chose qu’une nouveauté pour les marxistes. À l’entrée dans le nouveau millénaire, la société « fordiste » – qui avec ses apparentes solides conquêtes syndicales, avec son welfare state, apparaissait, et était, la phase la plus avancée du capitalisme – se révèle aujourd’hui, avec ses « amortisseurs sociaux », avec ses « contrats collectifs », avec ses « syndicats collaborationnistes », comme l’ultime seuil d’un capitalisme non encore pleinement déployé, contraint à garantir à ses esclaves, pour assurer la continuité et la qualité de la production, des conditions qui auraient suscité l’envie du travailleur des manufactures du XVIIIe siècle. Jamais comme à l’ère de la production et de l’emploi « flexibles » ne s’est vérifiée la vision de Marx d’une société dans laquelle « se volatilise tout ce qu’il y a de corporatif et de stable, ou est profané toute chose sacrée, et ou les hommes sont contraints de regarder d’une manière désenchantée leur propre position et leurs rapports réciproques », une société qui « va se divisant toujours plus en deux grands camps ennemis, en deux grandes classes directement opposées l’une l’autre : bourgeoisie et prolétariat »[135]. Une fois passé le seuil de la prochaine récession, le prolétariat d’aujourd’hui, avec son petit portefeuille de titres et ses garanties « fordistes » comme le paiement du chômage, la « propriété de sa maison » hypothéquée par l’emprunt au lieu d’être louée, découvrira à la fin ce que veut dire être « sans réserves ».
Par rapport au capitalisme d’il y a cinquante ans, celui d’aujourd’hui qui se délecte de ses prétendus triomphes présente sans démenti possible une masse de contradictions si violentes et menaçantes que nous ne parierions pas un sou sur le fait que l’actuel cycle d’expansion puisse être de longue durée. De 1975, point bas du cycle précédent, à aujourd’hui, vingt cinq ans sont passés, presque autant que les « trente glorieuses ». Même en comptant à partir de 1982, année signant une nouvelle récession mineure et le début de la phase actuelle, vingt ans se sont désormais passés. Avec une situation financière explosive comme celle que nous vivons, le pronostique lancé par Soros d’une « désagrégation imminente du système capitaliste global »[136] est tout autre qu’oiseux.
Il est cependant arrivé trop souvent que les révolutionnaires aient vu la fin de la production capitaliste pour pouvoir encore commettre l’erreur de faire du catastrophisme à bon marché. Dans la mesure ou la société du capital réussit à survivre les contours qu’elle pourra prendre sont déjà visibles.
Avant tout du point de vue de l’organisation sociale : comme cela a déjà été argumenté plus en détail dans un autre article de « Bolletino »[137], est en cours un vaste re-engineering de la journée de travail et des temps sociaux destinés à changer les rythmes de vie en s’éloignant toujours plus du modèle synchronisé, actuellement dominant, de la société « fordiste » – avec son alternance de travail et de temps libre égaux pour tous ou presque, avec les soirées en famille devant la télévision – qui feront un jour l’impression que laissent aujourd’hui la mémoire des grands-parents sur les délices bucoliques de la société rurale avec ses veillées hivernales. C’est ainsi qu’avance la diachronie de la société « post-fordiste »qui, reproduisant à l’échelle générale la production par « îlots », brise le peu de cohésion familiale et de groupes sociaux qui pouvaient encore survivre dans la société « fordiste », obligeant les individus, comme des monades qui s’annulent perpétuellement, à tourner en tourbillonnant dans le « réseau » global des nouveaux moyens d’organisation du travail et de communication interpersonnelle : le travail à la chaîne cède la place au travail en groupes ou au télétravail, le travail de jour au travail posté, les assemblées publiques au « peuple du fax », la famille réduite à deux plus deux au single, la salle de cinéma par le magnétoscope, les loisirs collectifs par les jeux virtuels, les lieux de rencontre par l’internet, le couple, l’amitié et la famille par… le club des cœurs solitaires.
Mais même du point de vue technologique le capital est déjà en train de courir vers un nouveau modèle de développement. Des grandes découvertes du vingtième siècle, l’énergie nucléaire et l’ADN, il semble que la seconde soit la plus prometteuse pour l’avenir du capitalisme. Si l’informatique est désormais rentrée dans chaque pores de la vie sociale, les biotechnologies seront la grande affaire du XXIe siècle.
« … la possibilité d’isoler, identifier et recombiner les gênes fait du pool génétique une nouvelle matière première pour l’activité économique future. Les techniques de l’ADN recombinant et des autres biotechnologies permettent aux scientifiques d’identifier, manipuler et exploiter les ressources génétiques à des fins économiques spécifiques. […] Notre but ultime est de rivaliser avec la courbe de croissance de l’ère industrielle. En produisant des matériaux vivants avec une rapidité supérieure à celle de la nature et en convertissant le matériel vivant en résultant en une corne d’abondance économique. […] Dans l’industrie minière, les chercheurs développent de nouveaux micro-organismes capables de remplacer les mineurs et leurs machines […] »[138].
« L’agriculture tout entière pourrait se trouver au beau milieu d’une grande transition, avec une quantité toujours supérieure de nourriture et de fibres croissant à l’aide de bactéries à l’intérieur de gigantesques bains de culture, le tout à un prix bien inférieur à celui des variétés qui croissent en pleine terre. […] Des millions de paysans, aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés, pourraient être arrachés à leurs terres, créant un des plus grands bouleversements sociaux de l’histoire du monde »[139].
Le contraste entre U.E. et U.S.A. au W.T.O. de Seattle sur les productions végétales transgéniques illustre mieux que n’importe quel exemple nos propos.
À côté des biotechnologies, dont le fabuleux développement est une conséquence de celui de l’informatique qui a permis de gérer les millions d’informations nécessaires à la compréhension des gênes, existe aussi une branche générée elle-même par l’informatique, l’autre trésor du capitalisme : nous voulons parler des télécommunications, destinées à avoir pour l’humanité un rôle analogue à celui de l’invention de la presse : de même que cette dernière avait rendu immensément plus économique la diffusion des connaissances en les soustrayant par ailleurs aux innombrables erreurs et aux nombreuses interprétations ou censures arbitraires de l’exégète et du copiste, et de même que le papier imprimé a contribué à combattre l’analphabétisme en ouvrant la porte au monde moderne, le « réseau intelligent », extension électronique et cybernétique des capacités mentales et de communication de l’homme, est destinée non seulement à modifier les systèmes de production se dégageant toujours plus de la concentration physique, mais aussi à créer de nouveaux besoins sociaux : de même que le livre n’existait pas avant Gutenberg, les nouvelles marchandises naissent du « grand frère » qui enveloppe « en temps réel » le monde entier.
Le capitalisme reçoit une autre impulsion vers de nouveaux secteurs et de nouvelles productions de par ses contradictions même : les théoriciens des Limites du développement[140] et du Club de Rome avaient prédit la fin du système industriel à cause de l’épuisement des ressources naturelles. Au contraire, la « crise énergétique » a poussé à la recherche de ressources alternatives et à la préparation de techniques d’économie d’énergie ainsi qu’à la rentabilisation de ressources jusqu’alors non-exploitées, avec le résultat que le pétrole est loin d’être épuisé et que son prix en dollars constants n’est pas aujourd’hui très différent de celui de 1973, avant la « crise du pétrole ». Les démographes avaient prédit un accroissement de la population tel qu’il causerait l’épuisement des ressources alimentaires de la planète alors qu’au contraire nous sommes submergés de productions excédentaires qui ne trouvent pas d’acquéreur pendant que certains prédisent la « fin de l’agriculture » avec sa substitution par des procédés industriels biotechnologiques. En même temps, la tendance à l’accroissement de la population est notablement diminuée dans les pays occidentaux rendant indispensable le recours à l’immigration. Il est permis à ce point de supposer que d’autres problèmes gigantesques posés par le développement capitaliste, comme l’effet de serre, la pollution et la croissance des mégapoles trouveront – dans la mesure ou il en naîtra de nouvelles branches susceptibles d’offrir un profit – une solution relative.
Il est clair pour nous marxistes que ces contre-tendances du capitalisme à l’aggravation de ses contradictions ne résoud pas et à terme aggrave la contradiction fondamentale du capital, c’est-à-dire le conflit entre développement social des forces productives et appropriation privée des fruits du travail : celle-ci entrave toute production, toute technique dans les limites de la production de profit, et d’une masse croissante de celui-ci. Cette nécessité se traduit en dernière analyse par l’effort d’épargner le travail, c’est-à-dire en une augmentation – bien que de nombreuses tendances s’y opposent – de la part constante du capital (ateliers, machines, matières premières, etc.) par rapport à sa part variable, c’est-à-dire au montant des salaires, ce qui signifie diminuer le rendement, le taux de profit, de tout capital additionnel investis. Tendance à laquelle le capital ne peut réagir que par la rationalisation de la production et en augmentant la masse des marchandises, jusqu’au moment où le mécanisme se bloque – après une lutte terrible entre capitaux pour s’éliminer – et où succède la crise. Notre perspective « pour le nouveau millénaire » reste donc fermement celui de la révolution internationale de la classe ouvrière, la perspective du communisme.
Mais il ne faut pas commettre envers le concept de chute du taux de profit l’erreur des catastrophistes bourgeois envers les « limites du développement » : il n’existe pas de limites absolues contre lesquelles il puisse s’abattre. Et de même que la crise n’est pas seulement pour le capital une menace mais aussi une promesse de régénération, la chute du taux de profit n’est que le revers de la médaille de la masse croissante de profits produits. « Chute du taux de profit et accélération de l’accumulation sont simplement des expressions différentes d’un même processus, toutes deux expriment le développement des forces productives »[141].
Pour ces mêmes motifs, une vision « économiciste » de la crise historique du capital qui ferait tout dépendre des cycles (brefs ou « longs ») de la conjoncture, de l’estomac finalement vide de la majorité de la classe ouvrière, serait totalement inadéquate à la compréhension de la complexe dynamique capitaliste. Ce n’est pas un hasard si le « Capital » de Marx ne s’occupe que marginalement du problème des cycles : ce qui l’intéresse n’est pas la détermination anticipée et abstraite des moments favorables à la révolution mais la critique du mouvement du capital social global dans sa totalité. Il ne nous parle pas seulement d’accumulation et de chute du taux de profit, mais de marchandises et d’argent, d’armée industrielle de réserve, de disproportion entre les différentes sphères, de rotation et de circulation du capital, de rente foncière, de crédit, de concurrence. C’est à tous ces aspects dans leur ensemble organique que Marx tire la condamnation historique du système présent. Le capital ne va pas mourir parce que tous les trente ou cinquante ans sa production chute brutalement pour une période plus ou moins longue, mais parce que, quelque soient la croissance de la production et du crédit, ses contradictions permanentes, ses crises, ses guerres le rendront insupportable à l’humanité. Et la classe ouvrière n’est pas révolutionnaire parce qu’elle est celle qui souffre le plus, ou l’unique à souffrir, en matière de salaires, de rythmes de travail et de chômage, des effets destructifs du cycle capitaliste. Elle l’est parce qu’elle est l’unique dont les antagonismes avec le capitalisme soient incompatibles, parce qu’elle représente l’avenir. Le capital ne mourra pas seulement parce que tous les trente ou cinquante ans il baisse les salaires et licencie, mais parce qu’il le fait après avoir créé une situation permanente d’incertitude et de souffrances sociales sous de multiples points de vue.
Le déterminisme d’opérette qui réduit tout à l’attente messianique d’une catharsis mathématique ou d’une Némésis est une vulgaire contrefaçon des puissants efforts de compréhension du cours complexe du capitalisme historiquement établis par l’école marxiste. Il faut donc éviter les simplifications déployées par ceux qui se rendent ridicules et leurs épigones infantiles, et leur opposer l’« étude des phénomènes particuliers du développement du capitalisme, desquels, le caractère de la méthode étant donné, on doit incessamment tirer la vérification et le contrôle de la théorie générale et la preuve de son efficacité ».[142]
Peut-on – sur la base de cette synthétique digression, de laquelle nous avons tiré de manière sûre de nombreux aspects importants sélectionnant ceux qui sont les plus significatifs – tenter de dresser un bilan utile à la compréhension du siècle écoulé et, encore plus, de l’avenir proche ? En premier lieu il faut absolument constater, malheureusement, qu’à un siècle des prévisions d’Engels que nous avons rappelées au début de ce travail et à quatre-vingts ans de la révolution russe, non seulement la perspective de la révolution ne s’est pas réalisée mais elle n’est pas au nombre des possibilités proches. À partir de 1927 – après un siècle qui, culminant avec la révolution russe, fut un mouvement montant d’ensemble malgré des coups d’arrêt temporaires – le mouvement de la classe ouvrière en tant que mouvement révolutionnaire, c’est-à-dire en tant que mouvement indépendant, a diminué progressivement. À la fin de ce siècle, donc, la révolution russe, plutôt que comme le début de l’ère de la révolution mondiale, apparaît désormais comme le grand mouvement annonciateur du futur qui clôt une période historique, le grand événement qui résorbe et résume les caractères de toute une époque de l’histoire européenne marquée par l’impulsion prolétarienne aux transformations du tissu social. Transformations qui tous comptes faits ont aplanis la route à la domination du capital et ont fait mûrir, à l’Est comme à l’Ouest, en 1848 comme en 1917, les conditions de la société bourgeoise. Au sein de ces mouvements, toutefois, la classe ouvrière – une classe ouvrière, nous pouvons le dire aujourd’hui, liée encore au passé par certains côtés si on la compare au « nouveau » prolétariat de l’ère de la « globalisation » – a mené, sur un arc de cent ans, ses premières, grandioses expériences, élaborant les formes de lutte économique et politique (syndicat, parti et dictature du prolétariat), la tactique envers les autres classes et organisations politiques, envers la guerre impérialiste, envers les institutions démocratiques comme envers la dictature ouverte de la bourgeoisie et le stalinisme, affrontant les questions nationales et agraires. Les enseignements de la révolution russe et du premier après-guerre, c’est-à-dire du plus récent et grandiose des mouvements prolétariens autonomes, se résument ainsi dans l’impossibilité de la victoire sans la cohésion et l’intransigeance du parti révolutionnaire et la dictature de classe monoparticiste, ainsi que dans le refus des « fronts » avec les forces opportunistes et de la gauche institutionnelle et le refus du front « antifasciste » et de la fausse alternative « démocratie-fascisme ».
Une fois épuisé le grand élan qui semblait entrouvrir au vingtième siècle la perspective du communisme, la réaction capitaliste, sous ses diverses formes, stalinienne, fasciste et démocratique a procédé à la plus gigantesque vague contre-révolutionnaire de l’histoire du capitalisme, combinant les effets de la violence et de l’anéantissement physique avec ceux de la corruption parlementaire et d’une complète dégénérescence doctrinaire et organisative du mouvement ouvrier.
La réaction bourgeoise ne s’est pas développée seulement sur le plan politique mais aussi sur le plan social et de la réorganisation de l’appareil d’état, intégrant les méthodes institutionnelles, les instances réformistes et totalitaires et donnant vie à un mécanisme de contrôle social bien plus fournis dans la gestion prévoyante et « forte » des leviers du pouvoir, aussi bien dans la sphère politique qu’économique.
Dans le champ économique, les grandes convulsions de la première moitié du vingtième siècle ont engagé une gigantesque reconversion mondiale du capitalisme qui, célébrant les triomphes du productivisme et de la société « fordiste », a poursuivi à travers une période de croissance inusitée une transformation « forte » de toute la société.
La crise de ce « modèle de développement », comme l’appellent les bourgeois, finalement surpassée, ne fut pas suffisamment forte pour arracher la classe révolutionnaire au syndicalisme collaborationniste et au réformisme bourgeois. Les travailleurs arrivèrent dans cette période après les défaites de la première moitié du siècle et les effets hypnotiques des « trente glorieuses » en ayant perdu leurs traditions de classe. La réaction prolétarienne, limitée à ses aspects trade-unionistes, fut coupée à sa naissance.
La nouvelle phase de restructuration du capital initiée par la crise du « fordisme », bien qu’empirant de manière générale certains aspects de la condition prolétarienne, n’a pas porté à une recrudescence de la lutte classiste : en créant un marché du travail différencié entre travailleurs à poste fixe et de vastes couches de précaires, en fermant dans certains secteurs les grandes usines, en prolétarisant des couches de techniciens et d’employés, en introduisant de manière toujours plus massive de la main d’œuvre immigrée, en rendant superflu par l’automatisation le professionnalisme résiduel de secteurs entiers du prolétariat, en dissolvant et transformant une portion considérable de la vieille classe ouvrière syndicalisée, elle a créé une spirale dépressive ultérieure du mouvement ouvrier, arrivant à expulser des lieux de travail même la tradition trade-unioniste et la base des syndicats officiels.
Pour toutes ces raisons, le XXe siècle représente, à partir de 1927, une authentique contre-réforme du capitalisme, c’est à dire non pas un phénomène contre-révolutionnaire passager mais une action complexe de modernisation des structures ankylosées et de récupération des énergies sociales : de même que l’Église catholique au Concile de Trente a su réagir à ce premier assaut prémonitoire de la future société bourgeoise connu sous le nom de « réforme » par un profond rajeunissement de ses structures, en plus d’une répression sans pitié, la société bourgeoise a su, après l’Octobre rouge, régénérer son organisme grâce à de nouveaux et puissants anticorps qui ont su attaquer la maladie qui l’avait envahie.
En soi une crise, même grave, n’assure pas une reprise de classe. On peut dire la même chose de la guerre. Pour les motifs déjà indiqués, le prolétariat comme force active de l’histoire fût absent aussi bien après 1929 que pendant la seconde guerre mondiale et la crise de 1973–75. A plus forte raison, même si celle-ci était relativement proche – ce qui n’a rien d’impossible puisque le cycle d’expansion américain, exceptionnellement long, est destiné à finir – la prochaine et inévitable vague de récession du capitalisme ne garantirait ni une immédiate ni une sûre reprise de la lutte de classe. Après une aussi longue absence historique, celle-ci ne pourra être que longue et douloureuse. Celui qui cherche gratifications et résultats ferait donc bien, pour une longue période, de se tenir à distance du mouvement communiste, et fréquenter les lupanars de la politique à la page, les fronts pacifistes anti-américains, les associations humanitaires et les secteurs du commerce équitable.
Les confirmations du marxisme au cours du siècle écoulé sont toutefois si évidentes sur le plan général qu’elles rendent inévitable, à plus ou moins long terme, le conflit entre travail salarié et capital. Certes ce conflit prendra des aspects nouveaux, reflets de la transformation de la configuration du prolétariat subie au cours du XXe siècle. En ce qui concerne les classiques et indépassables revendications sur le salaire et l’horaire de travail la classe sera portée, de par la nécessité de réagir à son actuelle stratification, à avancer des revendications unifiantes et solidaires des couches les plus précaires et « flexibles » de la main d’œuvre, et donc à trouver un terrain d’organisation qui permette d’unir transversalement – c’est à dire au delà des limites de lieux de travail et de différences de catégories – les prolétaires aux conditions incertaines, les travailleurs « atypiques » (travail à temps partiel, contrats précaires de tous ordres, etc.). Il est difficile de se représenter ce que seront les formes de mobilisation par rapport à celles du prolétariat « fordiste », les luttes articulées et massives, avantageuses pour les travailleurs puisqu’elles pouvaient bloquer complètement les chaînes de production et déjà moins efficace au sein de la production « toyotiste » en « îlots »; le même destin vaudra pour les formes d’organisation qui sortaient de la lutte comme les conseils d’usine. Il n’est pas dit que dans l’avenir ce ne soit pas des organisations territoriales plutôt que les organisations de branche, d’usine ou de catégorie, qui auront un rôle d’entraînement.
Ce qui est arrivé à Seattle – où ont défilé 1200 organisations de 85 pays – a peu de choses à voir avec la classe ouvrière mais montre quelle dimension internationale peut avoir en peu de temps un mouvement, et la violente réaction de l’ordre établis contre une mobilisation démocratique fait comprendre comment les contradictions objectives du système peuvent exploser de manière incontrôlée.
Les 140 jours de grève des techniciens et ingénieurs d’ELF pour sauver 1500 des 4000 emplois liés à la recherche et à la gestion informatique font entrer en scène à leur tour les travailleurs privilégiés qui sont par ailleurs actionnaires de la compagnie et laissent entrevoir les potentialités d’élargissement du front de la lutte de classe permise par la prolétarisation progressive des couches intermédiaires.
Un exemple des voies que la classe ouvrière pourrait prendre dans le futur vient des ouvriers de l’UPS, la gigantesque société américaine (6 % du PIB, 338 000 employés, dont 200 000 aux USA) qui contrôle 80 % du transport des paquets des USA et possède de nombreuses filiales à l’étranger. La tentative de coordonner la majorité des employés, dont 60 % sont précaires, dans une lutte pour l’augmentation des salaires et une plus grande stabilité de l’emploi a été couronnée par un succès relatif[143] pour la première fois. Malgré l’ambiguïté d’une mobilisation qui a reçue pour des motifs contingents l’appuis des bonzes syndicaux officiels, il s’agit de la première lutte de grande ampleur qui ait intéressé le nouveau prolétariat de l’ère du « capitalisme global »[144].
La disparition de la tradition d’organisation de classe, tant syndicale que politique, rend malheureusement probable dans le futur mouvement prolétarien la confusion entre les deux plans : c’est ce qui est advenu lors du dernier épisode de lutte du prolétariat occidental entre 1960 et les premières années 70. De manière certes différente de cette époque, liée à la prédominance de ce qui fut appelé « l’ouvrier masse » de type « fordiste », le problème se présentera à nouveau. En raison de la profonde détérioration de l’image du communisme opérée par les pays « socialistes » et les « communismes » nationaux s’y ajouteront quelques suggestions anti-marxistes, d’origine petite-bourgeoise, anarchiste et ouvriériste. Ceci contraindra les communistes à se confronter à une situation sans précédents dans l’histoire ou des éléments déjà dépassés par le mouvement ouvrier se mélangeront à des impulsions positives de l’action de classe.
En tout cas il est hors de question que réapparaisse une pure et simple reproposition de ce que le mouvement ouvrier a été dans le passé. Celui qui attend le drapeau rouge et les cols bleus dans des manifestations chantant l’Internationale et brandissant des portraits de Lénine sera déçu. La nouvelle dimension que la lutte internationale prolétarienne assumera en conséquence de son extension à de nouvelles ères dans le monde et sur les cinq continents contribuera à la variété et au progrès de ses formes : de même que le « barbare » prolétarien russe à créé les Soviets, de même les jeunes classes prolétariennes des pays « en voie de développement » enrichiront l’expérience internationale de la lutte de classe. Ce n’est pas d’un point de vue symbolique que l’irruption des prolétariats africains, asiatiques, latino-américains dans l’histoire introduira dans les conflits travail salarié-capital un langage, des slogans, des positions qui d’une part chercheront (et devront !) à se rallier aux traditions passées du mouvement ouvrier et de l’autre tireront du matériel extrait de l’humus social et « culturel » des diverses ères géohistoriques, les fondant – lorsque la reprise révolutionnaire sera d’une ampleur suffisante – avec les sentiments et les aspirations particuliers du prolétariat contemporain « globalisé » des métropoles industrielles.
Ce dernier, indubitablement, restera la force déterminante de la future vague révolutionnaire, mais si le mouvement ouvrier, du XIXe siècle au premier après-guerre, a laissé son empreinte sur l’histoire du capitalisme, ce fut surtout en Europe et dans le monde occidental. Celui du XXIe siècle sera mondial et donc plus complexe. Ceci posera de nouveau le problème d’une tactique internationale qui pourra et devra inclure la tendance à l’unicité que la Troisième Internationale n’a pu porter à bonne fin, et en l’absence de quoi la victoire est impossible. On ne devra pas moins s’affronter avec la structure complexe et différenciée des cinq continents qui par des voies diverses, de manière différente, et dans certaines aires sans avoir dépassé les restes de pré-capitalisme ni le colonialisme, ont commencé à faire partie du système et du marché mondial. Il ne s’agira pas d’« enrichir » de « nouvelles découvertes » le marxisme dont les postulats restent valables pendant tout le cours historique du capitalisme mais de comprendre que par exemple la question agraire n’est pas la même en Asie et en Afrique, et que le problème national se pose – ou ne se pose pas encore – dans le continent noir de manière différente de l’Amérique Latine. Et dans aucun de ces cas l’expérience « occidentale » passée du mouvement prolétarien, qui continuera cependant à constituer la base à laquelle on ne peut renoncer de tout progrès de la lutte de classe, ne pourra en soi fournir des réponses satisfaisantes.
Le développement du vingtième siècle, répondant rigoureusement aux lois de la théorie marxiste, a toutefois offert un développement de la lutte de classe qui auraient stupéfiés Marx, Engels et Lénine. Une pause du mouvement ouvrier telle que celle ci qui avoisine les quatre-vingt ans est un inédit dans l’histoire. Il n’est pas étonnant que des erreurs de perspectives aient été commises : « l’histoire ne se fait pas, encore une fois, et il est salutaire de la déchiffrer. […] Même si on n’en définit pas la voie sûre, ce qui pourrait d’ailleurs conduire au fatalisme, qui nourrit l’impuissant né […] : on établit seulement quelques liens entre des conditions données et les développements correspondants »[145]. Se refuser à admettre – face aux leçons de l’histoire – qu’il n’existe pas pour le capital de crise sans voie de sortie; se refuser à admettre, devant l’évidence des faits, que la crise historique aiguë du capitalisme est encore à venir, signifie contrefaire le marxisme, ne pas être en mesure – comme le fut la gauche communiste des années 50 – d’admettre la défaite et de ré-élaborer la certitude de la victoire.
Ceux qui, face à la complexité des phénomènes sociaux, face aux revers subis, face à la prolongation de la défaite, essaient néanmoins de mettre le marxisme en pilule, avec leurs petites recettes indiquant que tout est prévu, que tout est écrit, comme l’écrit Lénine « devraient être immédiatement taxés de purs imbéciles »[146]. La théorie est grise, qui avance difficilement et à pas lents derrière les séismes de l’histoire, mais l’auberge de la vie est verte, où prolifèrent constamment les innombrables formes de la vie sociale. Fermer les yeux face à ceci signifie réduire la théorie à une mantra bouddhiste dont la répétition console l’esprit pendant que la chaire souffre. Regarder les faits en employant l’implacable arme de la dialectique qui dissout toute forme de rigidité, tout jugement à priori, est le digne objet du marxisme révolutionnaire.
« À peu d’exceptions, tout épisode important de l’histoire révolutionnaire […] porte le titre : Défaite de la révolution ! Celui qui a succombé à cette défaite n’est pas la révolution. Ce furent les formes traditionnelles pré-révolutionnaires, résultats de rapports sociaux qui n’étaient pas encore arrivés à devenir de violents contrastes de classe, les illusions personnelles, les idées projetées dont le parti révolutionnaire ne s’était pas encore débarrassé […]et dont pouvaient le libérer […] seulement une série de défaites. En un mot : le progrès révolutionnaire […] se fraye une voie […] en faisant surgir une contre-révolution serrée, puissante, en faisant surgir un adversaire que seul le parti de l’insurrection peut combattre en atteignant la maturité d’un vrai parti révolutionnaire »[147].
Le mouvement ouvrier saura-t'il faire sien le trésor de ses propres erreurs ?
Notes :
[prev.] [content] [end]
F. Engels, Préface à l’édition allemande du « Manifeste » du Parti Communiste de 1890 dans « Manifeste du Parti Communiste », Einaudi, Turin 1962. [⤒]
Engels à Bernstein, 22–25 février 1882, cité dans F. Andreucci, « Socialdémocratie et impérialisme », Rome, Ed. Riuniti, 1988, p.94. [⤒]
F. Engels, Introduction de 1895 à « Les luttes de classe en France » de Marx, Rome, Editori Riuniti, 1962. [⤒]
F. Engels : « Le parti socialiste et la paix », dans F. Engels, « La politique extérieure des tsars », Milan, La Salamandra, 1978, pp. 94–95. [⤒]
C.f. : M. Dobb, « Problèmes d’histoire du capitalisme », Rome, Ed. Riuniti, 1991, pp. 327 et suivantes. [⤒]
Note d’Engels au chap. XXX du « Capital » de Marx, Rome, Ed. Riuniti, 1970, 3 (2), p. 182. Engels avait néanmoins prudemment ajouté : « Il se peut cependant qu’il s’agisse seulement d’un prolongement de la durée du cycle » (ibid.). C’est depuis la « grande dépression » de la fin du XIXme siècle donc, et non à celle de 1929, que le cycle capitaliste, avec ses crises périodiques, présente une marche chaotique. [⤒]
A. Agosti, « Les internationales ouvrières », Turin, Loescher, 1973, p.21. [⤒]
V. I. Lénine, « La IIIe Internationale et son rôle dans l’histoire », « œuvres choisies », Rome, Editeurs réunis, 1965. [⤒]
P. Broué, « Révolution en Allemagne », Torino, Einaudi, 1971, pp. 10–20. [⤒]
Cit in ibid. [⤒]
Cit in ibid. [⤒]
V. I. Lénine, « Projet de résolution de la gauche à Zimmerwald », « Œuvres complètes », vol.21, p.317. [⤒]
M. Dobb, op. cit., pp. 339–342. [⤒]
E. Bernstein, « Les présupposés du socialisme et les tâches de la social-démocratie », Bari, Laterza, 1974. [⤒]
V. I. Lénine, « Le socialisme et la guerre », ibid., p. 283. [⤒]
Cf. la reconstitution du débat dans P. M. Sweezy, « La théorie du développement capitaliste », Turin, Einaudi, 1951, pp. 247 et suiv. [⤒]
R. Luxembourg, « L’accumulation du capital », Turin, Einaudi, 1960. [⤒]
K. Kautsky, « Théorie des crises », Florence, Guadagni editeurs, 1976. [⤒]
V. I. Lénine, « L’impérialisme, phase suprême du capitalisme », « Œuvres complètes », vol.22, p.266. [⤒]
V. I. Lénine, « Le socialisme et la guerre », op. cit., P. 275. [⤒]
V. I. Lénine, « La faillite de la IIe Internationale », « Œuvres complètes », vol. 21, p. 233. [⤒]
Dans A. Agosti, « La troisième Internationale », Rome, Ed. Riuniti, 1974, vol. I, I, pp. 23–30. [⤒]
E. J. Hobsbawm, « Le siècle en bref », Milan, Rizzoli, 1997, p. 112. [⤒]
Dans le gold exchange standard, la mesure d’échange internationale n’était plus l’or, mais en substance la livre sterling ancrée à l’or. [⤒]
Une reconstruction de la politique financière entre les deux guerres dans G. Alvi, « Le siècle américain », Milan, Adelphi, 1996. Un examen de la politique économique générale dans le texte de 1936 de O. Bauer, « Entre deux guerres mondiales ? », Turin, Einaudi, 1979. [⤒]
M. Dobb, op. cit. P. 359. [⤒]
Déjà en 1922 le roman « Babbit » de Sinclair Lewis (Milan, Corbaccio, 1993) décrit un protagoniste heureux de pouvoir jouir de « produits standard vantés par la publicité, dentifrice, chaussures, pneumatiques, appareil photographique, maillot de bain », et surtout de l’automobile, « poésie et tragédie, amour et héroïsme » (pp. 105, 30). [⤒]
S. Guarracino, « Les années mil neuf cent et leurs histoires », Milan, Bruno Mondadori, 1997, p. 144. [⤒]
Il faut noter que pour Marx le cycle capitaliste est la succession d’au moins quatre états de l’économie et non une simple succession booms-crises. [⤒]
Karl Marx, « Le Capital », II, Rome, Ed. Riuniti, 1970, 1, pp. 192–193. [⤒]
« Rapport sur la crise mondiale et les nouvelles tâches de l’Internationale communiste », 1921, in L. Trotsky, « Problèmes de la révolution en Europe », Milan, Arnoldo Mondadori, 1979, pp. 152–53. [⤒]
« Rapport sur la politique économique soviétique et les perspectives de la révolution mondiale », in ibid. p. 361. [⤒]
C.f. l’intervention de Boukharine au VIIe Exécutif élargi de l’I.C. dans le « Bulletin Communiste » Nr. 131 du 7/12/1926. [⤒]
M. Dobb, op. cit. P. 348. [⤒]
Pour une synthèse des analyses bourgeoises les plus représentatives sur la crise de 29, c.f. G. Are, « La grande dépression des années 30 », « Histoire contemporaine », № 1/99, pp. 29–60. [⤒]
M. Dobb, op. cit. p. 356–58. [⤒]
E. J. Hobsbawm, op. cit. p. 115. [⤒]
O. Bauer, op.cit., pp. 23–24, 28. [⤒]
L’affirmation récurrente des publicistes bourgeois (par exemple Milton Friedman) de ce que l’écroulement de la fin des années 20 doive être attribuée à la politique monétaire restrictive des gouvernements, et qu’une crise « de type 29 » ne puisse se réaliser est démentie par les analogies entre la « grande dépression » de la fin du XIXe siècle et celle des années 30 de ce siècle. En réalité ce sont les conditions mêmes de l’économie capitaliste mûre, basées sur un « énorme système de crédit » (Bauer), qui rendent inévitables de telles crises. Nous en reparlerons à propos de l’histoire plus récente de l’économie capitaliste. [⤒]
« Economist » du 18/3/1939, cité dans M. Dobb, op. cit. p. 361. [⤒]
Nous ne voulons pas ici associer la figure, bien qu’ambiguë, de Gramsci, avec celle, pleinement contre-révolutionnaire, du régime et de la politique stalinienne.[⤒]
F. Pollock, « Observations sur la crise économique », dans « Théorie et pratique de l’économie de plan », Bari, De Donato, 1973, p.169.[⤒]
« Il Comunista » du 17/11/1921. [⤒]
« Rapport du PCd’I au IVe Congrès de l’I.C. », « La correspondance internationale » du 22/12/1922. [⤒]
« Rome et Moscou », « Il Lavoratore » du 12/1/1923. [⤒]
« Rapport de la gauche du PCd’I au Ve Congrès de l’I.C. », « Protokoll des V. Weltongresses der Kommunistischen Internationale », séance du 2 Juillet 1924. [⤒]
« Rapport de la gauche du PCd’I au VIe Exécutif élargis de l’I.C. », 1926. [⤒]
« Que vaut une élection ? », « L’Unità » du 16 avril 1924. [⤒]
A. Paczkowski, « Pologne, la ‹ nation ennemie › », dans AAVV, « Le livre noir du communisme », Milan, Arnoldo Mondadori, 1997, p. 344. [⤒]
E. J. Hobsbawm, op. cit. p 59. [⤒]
S. Guarracino, « Le dix-neuvième siècle et son histoire », op. cit., p. 160. [⤒]
Ibid, p. 68. [⤒]
Dans la considération de l’évolution de l’Union Européenne on ne doit pas oublier que le (partiel) sacrifice des intérêts nationaux particuliers que celle-ci implique implicitement est toujours comparé à la situation de sujétion dans les confrontations avec Washington. [⤒]
C.f. : G. Pala, « Le Fond monétaire international », Naples, Laboratorio politico, 1996. [⤒]
S. Guarracino, « Histoire des cinquante dernières années », Milan, Bruno Mondadori, 1999, pp. 21–24. [⤒]
J. Fourrastié, « Les trente glorieuses ou la révolution invisible », Paris, Fayard, 1979.[⤒]
S. Guarracino, op. cit., pp. 135–140. [⤒]
E. J. Hobsbawm, op. cit., p. 307. [⤒]
Le « rapport Morris », prémisse d’une étude de la Chase Econometrics, affirmait au début des années 70 que « la période de croissance économique stable qui va de 1954 à 1973 sera jugé pour ce qu’il a vraiment été : une aberration », cité dans L. Maitan, « La grande dépression (1929–32) et la récession des années 70 », Rome, 1976, p. 103. [⤒]
G. Arrighi, « Le long XXe siècle », Milan, Il saggiatore, 1996, p. 388.[⤒]
Rosa Luxembourg, « L’accumulation du capital », Turin, Einaudi.[⤒]
E. J. Hobsbawm, op. Cit., p. 306.[⤒]
À titre d’exemple, au Japon la population rurale est passée de 52,4 % en 1947 à 9 % en 1985 et à 5 % environ actuellement (ibid., p. 342, « Le livre des faits », Rome, Adekronos Libri, 1999, p. 319). [⤒]
E. J. Hobsbawm, op. cit., p. 365; « Le livre des faits 2000 », op. cit., p. 318.[⤒]
« Théorie et action dans la théorie marxiste », « Bulletin interne » du Parti communiste international, Nr. 1 de 1951. [⤒]
Voir à ce propos le travail de Sweezy qui revalorise la position de Kautsky, « La théorie du développement capitaliste », op. cit. [⤒]
H. Grossmann, « L’écroulement du capitalisme », Milan, Jaka Books, 1971. On peut voir la réfutation de A. Pannekoek intitulée « La théorie de l’écroulement du capitalisme » dans D. Authier, J. Barrot, « La gauche communiste en Allemagne », Milan, La salamandra, 1981.[⤒]
N. Kondratiev, « Les principaux cycles économiques », Bologne, Cappelli, 1981. [⤒]
J. A. Schumpeter, « Le processus capitaliste. Cycles économiques », Editions Ridotta sous la direction de R. Fels, Turin, 1977. [⤒]
Cité dans G. Gavry, « La théorie des cycles longs de Kondratiev », dans N. Kondratiev, op. cit. p. 219. [⤒]
Citation de « Le cours du capitalisme mondial selon l’expérience historique et la doctrine de Marx », « Il Programma Comunista », Nr. 23 de 1957. Cette longue étude se poursuit sur les pages du journal à partir du Nr. 16 de 1957 jusqu’au Nr. 7 de 1959. [⤒]
« Le cours du capitalisme… », op. cit., « Il Programma Comunista » Nr. 17, 1957.[⤒]
Cité par D. Giachetti et M. Scavino, « La FIAT aux mains des ouvriers – l’automne chaud de 1969 », Pise, Editions BFS, 1999, p.7.[⤒]
S. Guarracino, « Histoire… », op. cit., p. 314. [⤒]
G. Arrighi, op. cit., pp. 389–390. De nombreux auteurs (c.f. par exemple G. Soros, « La crise du capitalisme global », Milan, Ponte alle Grazie, 1999, p. 146) font naître l’explosion du marché de l’eurodollar, c’est à dire le début de la « globalisation », au « choc pétrolier » qui à partir de 1973 mit entre les mains des producteurs de pétrole de considérables disponibilités financières (les fameux « pétrodollars »). [⤒]
Cité dans E. J. Hobsbawm, op. cit., p. 305. [⤒]
S. Guarracino, « Les années mille neuf cent… »;, op. cit., p. 209.[⤒]
G. Soros, op. Cit., p. 162. [⤒]
C.f. : J. Halevi, « USA et Japon, amis-ennemis », « La rivista del Manifesto », 1/12/1999.[⤒]
R. Batra, « Le crack financier, 1998–1999 », Sperkling & Kupfer, 1998, p. 95.[⤒]
« Mappemonde 1994 », Ed. Herodote; « L’état du monde 1988–1989 », Paris, Ed. La Découverte.[⤒]
C.f. : I. Warde, « Dow Jones, une bulle trop gonflée », « Le Monde Diplomatique », Nr. 10, octobre 1999.[⤒]
« L’état du monde 1994 », Paris, La Découverte, pp. 560, 574.[⤒]
I. Warde, op. cit. [⤒]
E. N. Luttwak, « La dictature du capitalisme », Milan, Arnoldo Mondadori, 1999, p. 241. [⤒]
F. F. Clairmont, « La nouvelle carte du pouvoir mondial », « Le Monde Diplomatique-Il Manifesto », décembre 1999. [⤒]
Galapagos, « Off-Shore, finances incontrôlées », « Il Manifesto » du 7/12/99. [⤒]
On découvrit alors que la LCTM avait des dettes dépassant plus de cent fois son capital propre (I. Warde, op. cit.). [⤒]
P. Krugman, « Le retour de l’économie des dépressions », Garzanti, 1999, en particulier chap. 7.[⤒]
C.f. : M. Deaglio, « L’Italie paye ses dus, Troisième rapport sur l’économie mondiale et l’Italie », Turin, Centre de recherche et d’études Luigi Einaudi, qui contient un chapitre d’analyse détaillée de la crise asiatique. [⤒]
G. Soros, op. Cit., p. 159. [⤒]
R. Batra, op. Cit. [⤒]
Cité dans E. Carretto, « Grande croissance synchronisée », « Corriere economia » du 4/10/99. [⤒]
C.f. : M. Revelli, « Economie et modèle social au passage du fordisme au toyotisme », dans « Rendez-vous de fin de siècle », Rome, Manifesto-libri, 1995. [⤒]
E. N. Luttwak, op. cit., pp. 101–102. [⤒]
K. Marx, F. Engels, « Manifeste du parti communiste », Turin, Einaudi, 1970, pp. 103–104. [⤒]
L. Thurow, « Tête à tête. USA, Europe, Japon. La bataille pour la suprématie économique dans le monde », Milan, A. Mondadori, 1992. [⤒]
Pirelli, par ex., a tout juste mis en route un nouveau process de production des pneus sur la base de « mini-usines […] en mesure de produire un pneu toutes les trois minutes », avec « une augmentation de la productivité de l’ordre de 80 % et une efficacité des installations de 23 %. La consommation d’énergie est réduite d’un tiers. Le coût total diminue donc de 25 % et la rentabilité augmente de plus de 40 %. Les travaux passent de 14 à 3, et il est possible de changer le modèle, suivant la demande, en 20 minutes ». Les mini-usines sont « hautement flexibles, faciles à déplacer sous forme de modules sur le territoire suivant les exigences du marché ». Les installations « de poche » occupent un espace inférieur de 80 % à celui des installations traditionnelles et peuvent donc être placées ou elles doivent servir avec facilité (S. Bocconi, « Pirelli, La révolution dans l’usine », « Il corriere della Sera » du 22/12/1999). [⤒]
C.f. : A. Negri, « La constitution du temps. Prolégomènes ». Rome, Manifesto-libri, 1997; M. Hardt, T. Negri, « Le travail de Dionysos », Rome, Manifesto-libri, 1995. [⤒]
K. Marx, F. Engels, « Manifeste du parti communiste », op. cit., p. 103. [⤒]
« The Economist », « Le monde en chiffres 2000 », « International », Rome, 1999. [⤒]
Les bourgeois les plus avertis se sont accordés sur le fait que les paramètres en usage n’étaient plus adaptés pour décrire et comprendre l’architecture actuelle de la production et réclament une révision des critères. C. f., par exemple, R. R. Reich, « L’économie des nations. Comment se préparer au capitalisme du troisième millénaire », Milan,; « Il Sole 24 Ore », 1993. [⤒]
« L’Europe en chiffres 1999 », Bureau des publications de la Communauté Européenne, « Il Sole 24 Ore », pp. 184–185. [⤒]
Une mise au point utile du débat sur le post-fordisme dans A. Bihr, « Le post-fordisme, réalité ou illusion ? », « Vis à vis », Nr. 7, 1999. [⤒]
C.f. : AAVV, sous la direction de M. Bergamaschi, « Question d’heures – Horaires de travail du XIXe siècle à aujourd’hui », Pise, BS Edizioni, 1997. [⤒]
M. Hunter, « Temps pour vivre, nouveau rêve américain », « Le Monde Diplomatique », novembre 1999. [⤒]
K. Marx, F. Engels, « Manifeste du parti communiste », op. cit., p. 104. [⤒]
Aux USA s’est réalisée, en relation avec le cycle d’expansion, une reprise du pouvoir d’achat des salaires, comme le montre le graphique. On doit cependant tenir compte de ce que les conditions générales de la classe ouvrière sont notablement influencées par le haut pourcentage de jeunes travailleurs précaires. [⤒]
A. Bonomi, « Le modèle Rhénan dans le chaos social », « Corriere economica » du 8/11/1999. [⤒]
C.f. : A. Sacchi, « Les négociations collectives en Europe entre corporatisme conflictuel et corporatisme associationniste », « Altreragioni » Nr. 7 de 1998. [⤒]
C.f. : AAVV, sous la responsabilité de M. Antoniolo et L. Ganapini, « Les syndicats occidentaux du XIXe siècle à aujourd’hui dans une perspective d’histoire comparée », Pise, BSEdizioni, sans date. [⤒]
W. McTell, « Dynamique de la crise politique et mutation de la composition des classes aux États-Unis », « Altreragioni », Nr. 5 de 1996, p. 101. [⤒]
C. f. : F. Graziani, « Modèles organisationnels et relations industrielles », « Altreragioni », n°4 de 1995. [⤒]
E. N. Luttwak, op. cit., pp. 110–112. [⤒]
M. Hunter, op. cit.,p. 405. [⤒]
E. N. Luttwak, op. cit. [⤒]
S. Guarracino, « Histoire… », op. cit., p. 405. [⤒]
U. Venturini, « Une autre frontière américaine », « Corriere economica » du 22/11/1999. [⤒]
C.f. : G. Arrighi, op. cit. Si théoriquement un tel développement ne peut pas être exclus, dans les faits on se trouve face à une différence spécifique entre les passages précédents de témoignage de la domination de l’économie mondiale et l’éventuel supplantation des USA : l’Asie, à la différence des États-Unis, ne constitue pas une nation unique. Et bien que la Chine possède des dimensions comparables à celles des États-Unis, elle ne peut pas se vanter sur son propre continent de posséder un arrière-pays tel qu’uncle Sam a trouvé dans les amériques. En tout cas un développement tel que celui suggéré par Arrighi ne pourrait pas intervenir en dehors d’un scénario de guerre pour la redéfinition des rapports entre puissances mondiales. [⤒]
K. Marx, « Histoire des doctrines économiques », Rome, Newton Compton, 1974, p. 475. [⤒]
Karl Marx, « Le Capital », op. cit., T.III, chap. I, pp. 305–312 des Ed. Corvisi. [⤒]
« Le cours du capitalisme mondial dans l’expérience historique et la doctrine de Marx », « Il Programma Comunista », Nr. 7, 1958. [⤒]
Karl Marx, Friedrich Engels, « Le Manifeste… », op. cit. p. 108. [⤒]
« Le cours du capitalisme… », op. cit., « Il Programma Comunista » n° 17, 1957. [⤒]
Postace de l’éditeur à AAVV, « ‹ Dites-le à Sparte › – Serbie et Europe – Contre l’agression de l’OTAN, Gênes », Graphos, 1999, p. 237. [⤒]
Typique de cette position le livre de Catone, Losurdo, Moffa, Taboni, « Du Moyen-Orient aux Balkans. L’aube sanglante du ‹ siècle américain › », Naples, La città del sole, 1999. [⤒]
Sur ces aspects, c.f. : Valter Zanin, « OTAN et Yougoslavie : le Protectorat des idées », « Altreraggioni », Nr. 9, 1999. [⤒]
F. F. Clairmont, op. cit.[⤒]
E. N. Luttwak, op. cit., p. 129, « Le livre des faits 2000 », op. cit., p. 309. [⤒]
Cité dans M. S. Sacchi, « A travail flexible, services inexistants », « Corriere economica » du 6/9/1999. [⤒]
Cité dans ibid. [⤒]
Sur ces aspects voir J. Rifkin, « La fin du travail », Milan, Baldini & Castoldi, 1995. [⤒]
K. Marx, F. Engels, « Le Manifeste… », op. cit., p. 109–111. [⤒]
Voir l’Introduction de Hobsbawm au « Manifeste » édité par Rizzoli en 1998. [⤒]
K. Marx, F. Engels, « Le Manifeste… », op. cit., p. 104, 101. [⤒]
G. Soros, op. cit., p. 141. [⤒]
C.f. : « Évolution du mode de production, journée de travail et taux de profit, points de réflexion sur la réduction de l’horaire de travail ». [⤒]
J. Rifkin, « Le siècle biotech », Milan, Baldini & Castoldi, 1998, pp. 35 et suivantes. [⤒]
Ibid, p.26. [⤒]
« Les limites du développement », Rapport du System Dynamic Group du Massachussets Institute of Technology au Club de Rome, Milan, EST – A. Mondadori, 1972. [⤒]
K. Marx, « Le Capital », III, Turin, 1975, p. 339. [⤒]
« Éléments d’économie marxiste », « Prometeo, revue de recherches et de bataille marxistes », Nr. 6, 1947, p. 282. [⤒]
C.f. : « Les amis de Marino van der Lubbe », « Il y a du pourri aux États-Unis : conflits aux Etas-Unis », « Communications des Wobbly », Nr. 4–5 nouvelle série, 1997–98. [⤒]
C.f. : « La grève à l’UPS – ‹ Part-time America don’t work ! ›, « Syndicalisme de base », Nr. 6, Mars 1998. [⤒]
« Structure économique et sociale de la Russie d’aujourd’hui », Mila, Editions Il programma comuniste, 1976. [⤒]
V. I. Lénine, « Sur notre révolution », dans « Lettres au Congrès », Rome, Ed. Riuniti, 1974. [⤒]
K. Marx, « Les luttes de classe en France », Rome, Ed. Riuniti, 1970, p. 89. [⤒]
